Par Pierre-Evariste Douaire
WK Interact a exposé en France sur les vitrines de Colette et des Galeries Lafayettes. Il place dans la rue ses personnages noirs sur fond blanc. Consacré à New York et exposé dans le monde entier, il revient en France pour un projet spécialement conçu pour Addict Galerie.
Double impact se tiendra du 16 mars au 17 avril 2007, dans ce nouvel espace consacré principalement aux artistes post-graffiti.
Pierre-Evariste Douaire. Peux-tu nous parler de tes personnages?
WK Interact. PlacĂ©s dans la rue mes personnages racontent des histoires. Ils obligent les piĂ©tons Ă se poser des questions. Que se passe-t-il? OĂą suis-je ? Ils sont toujours en mouvement, ils indiquent toujours des directions. Ce sont des saynètes qui s’additionnent les unes aux autres. Elles forment un rĂ©cit parcellaire que chacun peut reconstituer. Je montre toujours le paroxysme d’une action. Je pointe toujours un moment prĂ©cis. A chacun, ensuite, d’y aller de son interprĂ©tation pour savoir ce qui a prĂ©cĂ©dĂ©, et ce qui va dĂ©couler de tout cela.
Tu les représentes souvent cagoulés, ce sont des criminels, des terroristes?
Je m’adapte aux lieux que j’investis. ExpatriĂ© depuis quinze ans Ă New York, j’ai pris le rythme de cette grande ville qui autorise et interdit certains thèmes. La violence y est autorisĂ©e, elle ne choque personne. Mais en utilisant les codes amĂ©ricains je ne me sens pas violent pour autant. MalgrĂ© les cagoules et les flingues, tu ne verras jamais une flaque de sang ou un coup Ă©changĂ© dans mes travaux. La vraie violence est ailleurs. C’est une question de point de vue. Il serait choquant par exemple de reprĂ©senter un corps nu alors qu’ici la sensualitĂ© s’affiche sur toutes les affiches publicitaires. Ce genre de chose serait inimaginable Ă New York.
Tes personnages recouvrent les murs, ils ressemblent Ă des ombres.
Je ne trouve pas. Leur rĂ´le est de surprendre les passants. Ils doivent ĂŞtre remplis d’Ă©motions. L’image doit s’adapter au lieu et s’affranchir du cadre qui lui est assignĂ© pour ĂŞtre lĂ naturellement. Il ne faut pas que le personnage soit plaquĂ©. Il doit se substituer au flux de la ville.
Quel rapport tes personnages entretiennent-ils avec la rue?
Je recherche des coins de rues pour glisser mes personnages. J’entretiens une relation très Ă©troite avec la ville. Elle me permet de crĂ©er mes histoires. Elle est le terreau fertile que j’utilise pour Ă©laborer mes saynètes. Ces coins de rues sont des story boards qui se superposent les uns aux autres.
Pourquoi exposer dans une galerie?
Après avoir oeuvrĂ© pendant de longues annĂ©es dans la rue, après avoir cherchĂ© la rĂ©ussite Ă New York, exposer en galerie est un nouveau dĂ©fi. Le challenge consiste Ă ĂŞtre aussi bon Ă l’intĂ©rieur qu’Ă l’extĂ©rieur. Ce n’est pas Ă©vident et beaucoup d’artistes se cassent les dents. Cet exercice est pĂ©rilleux, et mĂŞme les meilleurs s’en mordent les doigts.
L’apprentissage par la rue permet de penser les lieux d’une manière très fine. Mais le passage en galerie rĂ©duit la fluiditĂ© de mes projets. PrĂ©occupĂ© par les notions de mouvements, j’ai du mal Ă exprimer la mĂŞme force dans une galerie. La fureur de la ville m’aide Ă©normĂ©ment dans la rue, elle amplifie mes installations.
A l’opposĂ©, un lieu d’exposition est beaucoup plus calme et il faut redoubler d’effort pour insuffler de la vie et du mouvement dans les images. Travailler in door reste un gros problème. Il faut beaucoup de temps et de maturitĂ© avant de pouvoir avancer des projets cohĂ©rents. J’ai tendance Ă entrer par effraction dans ces lieux magnifiques, un peu Ă l’image de ma première expĂ©rience dans le domaine.
Pour l’anecdote j’avais refusĂ© de peindre le mur immense de la galerie. Je m’Ă©tais contentĂ© de faire un trompe-l’œil sur la vitre de la porte. Mon personnage Ă©tait Ă la fois Ă l’intĂ©rieur et Ă l’extĂ©rieur. Sans ĂŞtre un leitmotiv, je poursuis dans ce sens en privilĂ©giant toujours ce double aspect des choses quand j’investis un lieu d’exposition.
Tu travailles toujours in situ?
Pour le projet de la galerie Addict, j’ai tout de suite Ă©tĂ© attirĂ© par le lieu. L’espace est situĂ© Ă l’angle de deux rues. Elle s’offre facilement aux regards des piĂ©tons. Une grande baie vitrĂ©e la ceinture. La frontière entre l’intĂ©rieur et l’extĂ©rieur est aboli. Intervenir en plein Marais est une expĂ©rience intĂ©ressante. C’est une situation assez unique, car les personnages dessinĂ©s sur les murs semblent ĂŞtre placĂ©s Ă l’extĂ©rieur. Il faut un moment d’attention pour comprendre le dispositif mis en place.
Pourquoi choisir d’abord la rue pour exposer?
Pour toucher des gens qui ne vont pas forcĂ©ment dans les galeries. La libertĂ© et la gratuitĂ© du geste ont beaucoup jouĂ© dans ma dĂ©marche. Mais pour autant, travailler dans le milieu urbain ne se rĂ©sume pas Ă troquer sa toile pour des murs. La ville est une matière vivante, c’est un corps sensible qu’il faut apprĂ©hender. Chaque quartier, outre son architecture, est habitĂ© par des habitants et traversĂ© par des piĂ©tons. Ce tissu urbain est fascinant Ă observer. Agir dessus l’est encore davantage. Les gens qui passent devant mes œuvres, dans la rue, prolongent mes histoires en emportant avec eux leurs questions. Leur imagination emporte ailleurs les silhouettes que je pose un peu partout.
L’aspect Ă©phĂ©mère de tes actions est important Ă tes yeux?
J’aime que le papier travaille, qu’il se dĂ©sagrège au fur et Ă mesure. Le temps s’invite dans mes interventions en patinant l’image. Cette Ă©volution est très intĂ©ressante Ă suivre. Après avoir collĂ© une affiche, je reviens plusieurs fois après pour suivre son chemin.
Tu es Français, mais tu es très rarement visible à Paris, excepté la réalisations de la vitrine Colette et celles des Galeries Lafayette.
Colette Ă©tait une super opportunitĂ©. La collaboration avec les Galeries Lafayette, s’est malheureusement soldĂ©e par une incomprĂ©hension mutuelle. J’avais la chance de travailler sur quinze vitrines Ă la fois. J’ai complètement intĂ©grĂ© la ville dans les vitrines. Je ne me suis pas contentĂ© de scĂ©nariser des jupes et des accessoires, j’ai totalement rĂ©inventĂ© les vitrines. La direction a Ă©tĂ© terriblement déçue, alors mĂŞme que les jeunes et les touristes Ă©trangers adoraient le concept. Mais je pense que les Galeries Lafayette ont dix ans de retard sur les autres enseignes. Je le dis d’autant plus volontiers que mon père, dans le passĂ©, en Ă©tait le directeur gĂ©nĂ©ral. Colette, Zara par contre sont en avance et continuent d’ĂŞtre Ă la pointe de la mode. Leurs vitrines en sont la preuve.
Tu en tires une leçon?
Je voyage Ă©normĂ©ment dans le monde et cette expĂ©rience me donne beaucoup Ă rĂ©flĂ©chir sur les Français et sur la mentalitĂ© du pays. La France est prĂ©occupĂ©e par son confort et sa qualitĂ© de vie. Elle prĂ©fère critiquer que crĂ©er. Le rĂ©sultat ne se fait pas attendre. Les crĂ©ateurs s’exilent et trouvent ailleurs les moyens qu’on leur refuse ici. Ils sont obligĂ©s de le faire car les Français prĂ©fèrent donner leurs chance Ă des Ă©trangers. On voit toujours les mĂŞmes artistes dans les expositions. C’est lassant Ă la longue, mĂŞme si on apprĂ©cie les artistes.
New York est plus dynamique?
Ce qui se passe actuellement Ă New York est incroyable. Les artistes des annĂ©es 1980 comme Keith Haring, Basquiat, ou Futura 2000 sont cĂ©lèbres depuis longtemps. Le plus Ă©tonnant aujourd’hui est la demande qui entoure les nouveaux artistes. Le phĂ©nomène n’est pas qu’amĂ©ricain, mais s’Ă©tend Ă toute l’Europe. Les grandes galeries new-yorkaises comme le MoMa s’interrogent sur le Street Art. Le Whitney Museum, le Moma ont des espaces gigantesques. Les galeries n’ont rien Ă voir avec les petites galeries du Marais. Les visiteurs pour un vernissage sont 8 000. La presse relaie l’Ă©vĂ©nement et les retombĂ©es sont Ă la hauteur de l’engagement. Ces musĂ©es s’ouvrent aux jeunes street artistes. En Angleterre trois artistes se disputent le marchĂ© et des petites toiles s’envolent Ă 120 000 euros. Paris, comme Ă son habitude, se contente de regarder passer les trains.
L’intĂ©rĂŞt pour le Street Art est un phĂ©nomène de mode?
L’effet de mode est passĂ© et un vrai marchĂ© se met en place. La critique emboĂ®te le pas et des essais sont consacrĂ©s au genre. Cet Ă©tat de fait oblige les musĂ©es Ă venir nous chercher, car ils sont pragmatiques. Ils se demandent si ce courant est digne d’intĂ©rĂŞt. Pour ne pas perdre ce marchĂ© colossal, ils invitent des artistes encore plus jeunes que moi Ă exposer. Le marchĂ© est tellement Ă©norme, la pression des collectionneurs est si forte qu’ils ne peuvent pas se permettre de laisser passer l’occasion. Ils prĂ©parent l’avenir. Ils ne veulent pas louper le coche. Les enjeux financiers sont Ă la hauteur de l’Ă©nergie crĂ©atrice de l’art urbain. Ce courant est international. Mais personne n’est dupe, il s’agit d’un pari sur l’avenir. Le choix peut se rĂ©vĂ©ler payant ou pas. Les anglo-saxons ne sont pas idiots, ils investissent aujourd’hui mais n’hĂ©siteront pas Ă tout arrĂŞter si l’expĂ©rience est dĂ©cevante Ă©conomiquement.
Comment expliquer l’ampleur du phĂ©nomène ?
La facilitation de l’information, la diffusion en masse de tous ces visuels entraĂ®ne dans son sillon un vĂ©ritable engouement planĂ©taire pour l’art urbain. Ce phĂ©nomène n’est pas perçu en France. Le monde de la mode n’est pas Ă©tranger Ă cet Ă©tat d’esprit. Cette industrie soutient Ă©normĂ©ment les jeunes artistes. Les grandes enseignes de la mode ont besoin d’eux pour leurs logos. Elles ont besoin de rendre reconnaissable leurs baskets et leurs tee-shirts. Elles ont besoin des artistes pour vendre leurs produits. Peu importe que le logo soit sur le vĂŞtement ou se fasse par le biais d’une campagne publicitaire. Pour prendre un exemple concret, aux États-Unis j’ai rĂ©alisĂ© le fronton d’une banque en y peignant un skateur. En France ce projet n’aurait aucune chance de passer. Vous prĂ©fĂ©rez vendre une voiture par l’intermĂ©diaire d’une jolie fille. Chaque pays fonctionne avec ses codes publicitaires.
Si tu devais intervenir sur les murs de Paris, comment le ferais-tu?
DiffĂ©remment qu’Ă New York. Formellement j’opterais pour un papier plus beige. Je renoncerais au blanc et noir que j’utilise en AmĂ©rique. Le marron me semble mieux convenir aux pierres de Paris. L’effet craquelĂ©, la recherche de matière, le rocailleux caractĂ©risent la capitale. J’aime le cĂ´tĂ© crasseux, modeste, pauvre d’un mur. Depuis que les murs sont nettoyĂ©s, protĂ©gĂ©s, la ville est aussi propre qu’une clinique, on frise Disney World. Les rapports culturels s’appauvrissent Ă la mĂŞme hauteur je pense.
Addict Galerie
14/16 rue de Thorigny
75003 Paris
www.addictgalerie.com







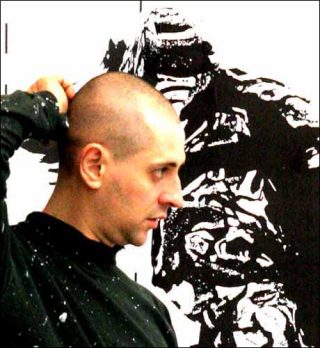

 parisART sur Instagram
parisART sur Instagram