Sur le plateau du Centre Pompidou, dÃĐpourvu de tout autre attirail quâune tÃīle de fond qui sera, au grÃĐ de la piÃĻce, ÃĐcrasante, immuable et froide, vibratile ou miroitante, cinq danseurs nous font face. InstallÃĐ au milieu de ses machines, percussions et autres guitares ÃĐlectriques, Brendan Dougherty reste attentif et concentrÃĐ. Ce face à face dans un silence absolu semble interminable: la tension monte, devient palpable, se transmet au public qui attend la dÃĐferlante de la vague Violet, le souffle coupÃĐ. Nous lâimaginons dÃĐvastatrice, tant lâÃĐlectricitÃĐ statique charge lâair. Elle arrive tout en douceur, elle se saisit dâabord dâune partie du corps bien particuliÃĻre, diffÃĐrente dâun interprÃĻte à lâautre, puis elle sâintensifie, tout comme le son.
Une description quasi phÃĐnomÃĐnologique est nÃĐcessaire pour dÃĐgager tous les enjeux de sa montÃĐe. Le mouvement sâinsinue dans les corps subtilement, de maniÃĻre inattendue, furtive: une rotation du torse, une crispation des paumes. Des nappes de son se posent, une respiration douce sâamplifie, devient trÃĻs vite une vague qui prend du corps et de la consistance.
Chaque interprÃĻte est dans son ÃĐnergie, dans son imaginaire et les vibrations de cette vague rÃĐsonnent diffÃĐremment dans chaque cage thoracique: lâonde de choc est diffractÃĐe et amplifiÃĐe dans les corps, enrichie, elle prend de la chair. Des images surviennent alors que le mouvement reste extÃĐrieur à toute intentionnalitÃĐ figurative: tel travail du bras ÃĐvoque un funambule cherchant des appuis dans lâair ou un Icare de la prÃĐhistoire de lâaviation.
La façon de se laisser travailler par un mÊme geste, la dynamique quâil crÃĐe en sâemparant des autres membres fait fortement penser à La levÃĐe des conflits de Boris Charmatz, avec une mÊme volontÃĐ dâexcÃĐder lâindividu et dâexplorer ce qui se tisse dans lâespace habitÃĐ entre. Les deux piÃĻces donneront naissance à des corps collectifs à lâÃĐchelle du plateau, dÃĐsincarnÃĐs dans la suspension du temps pour le chorÃĐgraphe français, monstrueusement organique pour Meg Stuart.
LâintÃĐrÊt de la chorÃĐgraphe amÃĐricaine se situe à un autre point et suit dâautres voies, lâimaginaire lâemporte sur le canon à partir duquel Charmatz construisait sa crÃĐation.
Des mouvements rÃĐpÃĐtitifs et saccadÃĐs, battements furieux de bras, font penser à des techniques de stimulation des ÃĐnergies spÃĐcifiques aux cultes de possession des religions animistes Vaudou, CandomblÃĐ ou autre SantÃĐria. Un danseur est à quatre pattes, un autre pousse de petits cris inarticulÃĐs, un autre semble vouloir embrasser lâair. Ils continuent à sâavancer vers le bord de la scÃĻne, mais bientÃīt la frontalitÃĐ se casse: chacun ÃĐvolue maintenant dans son espace. Les caractÃĻres nâont pas le temps de sâindividualiser et de donner chair à des personnages, si marquÃĐs dans ces cultes oÃđ chaque dieu a ses danses, ses humeurs, ses plaisirs et ses colÃĻres.
La musique persiste dans une certaine linÃĐaritÃĐ dÃĐposÃĐe par couches successives, travaillÃĐe par des pulsations qui se transmettent aux corps secouÃĐs, en proie à leurs ÃĐbats, assujettis parfois à de soudaines contagions de mouvements, sans quâil y ait le moindre contact entre leurs regards. La lumiÃĻre devient pulsatile, des flashes la dÃĐchirent. Une batterie sâajoute aux nappes ÃĐlectroniques dont les percussions, arythmiques, font dâavantage vibrer la paroi de fond.
Tout se passe dans la cage thoracique â tensions, crispations, sursauts â les danseurs cherchent des ÃĐquilibres internes, des voies secrÃĻtes.
Des cris dÃĐchirants retentissent et ouvrent vers des mondes insoupçonnÃĐs. Des moments dâexaltation extrÊme alternent avec dâautres dâaccalmie opaque, comme si les performeurs essayaient de se ressaisir. Câest à ces instants blancs quâon voit quâils sont dÃĐjà partis.
Brendan Dougherty commence à trouver les rythmes binaires irrÃĐguliers qui accompagnent et portent les danses de possession, les deux voix, en dÃĐcalage, ÃĐmergent parfois de la masse sonore, la tension monte par paliers, le volume et sa consistance deviennent ÃĐcrasants. Dans ce magma oÃđ lâintÃĐrieur et lâextÃĐrieur commencent à se confondre dans des tourbillons dâÃĐnergie, Kotomi Nishiwaki entame une lente et pÃĐnible avancÃĐe vers le bord de la scÃĻne, jusquâau bout du gouffre: le temps est suspendu et complÃĻtement ÃĐclatÃĐ dans son cri inhumain. LâÃĐnorme tension se dÃĐcharge dans un rythme effrÃĐnÃĐ qui secoue le plateau. Puis plus rien. Dans un silence qui tombe brutalement, les danseurs se trouvent dans un nouveau face à face, tout prÃĻs du public. Atterrissent-ils ou sont-ils en train dâaller plus loin, plus profondÃĐment dans leur voyage? Dâinfra-gestes irrÃĐpressibles, des forces et blocages encore tenaces marquent et travaillent les corps.
Brendan Dougherty pÃĐtrit un nouveau son fait de mini larsens, Ã la lisiÃĻre des interfÃĐrences sonores de lâamplificateur avec les battements du pouls dans ses veines ou au contact de ses paumes. Des mouvements lents, perdus, sâentament.
Un premier contact a lieu qui ÃĐpouse les surfaces de tout un corps. Les performeurs glissent doucement les uns sur les autres. Le musicien frappe les cordes dâune guitare ÃĐlectrique. A ces rÃĐverbÃĐrations rÃĐpondent des reflets dans la paroi miroitante qui frÃīlent lâaveuglement, tout en inondant le plateau des eaux tamisÃĐes douces. Une atmosphÃĻre ouatÃĐe enveloppe et protÃĻge les danseurs, alors que des scintillements sauvages empÊchent le public dâembrasser dâun seul regard tout le plateau, le contraignent à se pencher sur les dÃĐtails. Ce contraste est radical et subtil à la fois. Il facilite lâÃĐmergence de ce nouveau corps qui se forme par le contact total, dans la porositÃĐ des enveloppes corporelles. Les performeurs roulent les uns sur les autres, et ce rouleau compresseur les absorbe tous un par un. Une autre piÃĻce de Boris Charmatz, Herses, une lente introduction, nous vient à lâesprit. Pourtant, ce tas de membres, cette masse fourmillante, ne fait pas naÃŪtre lâimage dâun charnier, avec sa sourde violence, mortifÃĻre. Il y va chez Meg Stuart dâune chose de plus organique, mue par une vie dÃĐmesurÃĐe, autrement inquiÃĐtante: une force qui engloutit les corps, les fond dans un seul Être qui tourne sur lui mÊme et autour du plateau, avant de se dissoudre.
Comme si elle se souciait de ne pas complÃĻtement nous perdre, la chorÃĐgraphe retrouve pour le dernier mouvement de son opus un imaginaire plus attendu. Les danseurs sont en train de se recentrer dans des mouvements larges pour mieux se laisser en proies aux pulsations renouvelÃĐes du son. Les corps sâindividualisent comme des centres de lâespace et des origines du systÃĻme axial, dâoÃđ se dÃĐploient des oscillations sagittales, horizontales, verticales. Les vibrations de plus en plus rapides se transmettent dans les corps des spectateurs. Dans la lumiÃĻre noire, elles charrient lâunivers des rave parties. Et tout dâun coup, la piÃĻce sâarrÊte net, de maniÃĻre imprÃĐvisible: sans trop comprendre comment et pourquoi, les spectateurs sont encore dedans, pris dans des mouvements rythmÃĐs à 200bpm.

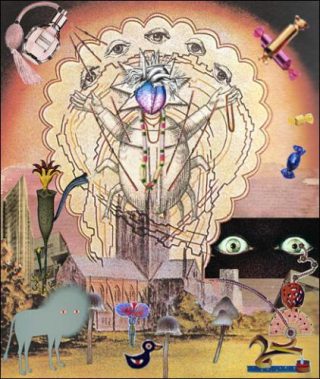

 parisART sur Instagram
parisART sur Instagram