La langueur estivale a ÃĐtÃĐ troublÃĐe par les humeurs amÃĻres du sang de la rÃĐpression en Syrie et en Libye, du sperme de lâoutrage sexuel à New York, et des larmes des peuples de tous les pays dâEurope, y compris la France, frappÃĐs de plein fouet par la crise financiÃĻre et les plans de rigueur, sous lâÅil à peine compatissant des maÃŪtres de la bourse dont les rÃĐsultats nets ont globalement crÃŧ au premier semestre de plus de 30%.
Câest sur ce fond de dÃĐsordres politiques, ÃĐthiques, sociaux et ÃĐconomiques profonds du monde que se prÃĐparent en France les ÃĐchÃĐances ÃĐlectorales, et que sâengage à nouveau le dÃĐbat sur la culture.
Tout a commencÃĐ Ã Avignon quand, le 17 juillet, Martine Aubry â premiÃĻre secrÃĐtaire du Parti socialiste, maire de Lille, candidate à la primaire socialiste en vue des ÃĐlections prÃĐsidentielles â a proposÃĐ dâaccroÃŪtre, si elle ÃĐtait ÃĐlue, le budget du ministÃĻre de la Culture de 30% à 50% (soit 200 millions dâeuros par an), pour notamment assurer ÂŦle financement de 10 000 emplois dâavenirÂŧ en faveur de 10 000 jeunes.
Ce nâÃĐtait pas le seul aspect de son propos que Le Monde a publiÃĐ a posteriori sous le titre ÂŦUn nouveau printemps pour la cultureÂŧ (26 juil. 2011). Mais câest celui qui a mis le petit monde de la culture en effervescence, en premier lieu le ministre qui a rÃĐagi par une interview à LibÃĐration (19 juil.), puis par une tribune libre au Monde (22 juil.).
Si la forme-interview rÃĐussit à peu prÃĻs à contenir son agressivitÃĐ, ses paroles frÃīlent parfois, comme souvent chez lui, le lapsus pour dÃĐriver sur des terrains douteux: ÂŦLâargent, dÃĐclare-t-il, ne sert quâà lubrifier. La focalisation sur lâargent rÃĐvÃĻle peut-Être une panne dâidÃĐesÂŧâĶ
Une telle difficultÃĐ Ã saisir les rÃĐsonances de son lexique sur sa propre rÃĐputation laisse perplexe et augure mal de sa luciditÃĐ.
Dans sa tribune libre du Monde, oÃđ plus rien ne le canalise, FrÃĐdÃĐric Mitterrand ÃĐructe littÃĐralement un amas dÃĐsordonnÃĐ de chiffres invÃĐrifiables, de vaines justifications (sur les vertus culturelles dâHadopi), de contre vÃĐritÃĐs (ÂŦle gouvernement a, et sanctuarisÃĐ, et augmentÃĐ le budget de la culture en 2011Âŧ), et de vieux slogans, le tout sous un titre pathÃĐtiquement triomphaliste: ÂŦPlaidoyer pour une politique culturelle du XXIe siÃĻcleÂŧ.
Là , ce nâest plus le lapsus qui mÃĻne subrepticement aux franges de pratiques dÃĐlictueuses; ce sont les clichÃĐs, les slogans, les accusations baignÃĐes de mÃĐpris, qui sont jetÃĐes à la figure en guise dâarguments.
Car il ne sâagit pas dâÃĐclairer la rÃĐalitÃĐ dâune politique, mais de la masquer: ÂŦLes piliers sur lesquels repose lâaction de lâensemble de mes prÃĐdÃĐcesseurs restent dâactualitÃĐ, affirme le ministre. Il sâagit dâassurer lâaccÃĻs du plus grand nombre aux Åuvres de lâesprit [âĶ], en dâautres termes la dÃĐmocratisation culturelleÂŧ.
Cela, le ministre lâassÃĻne sans vergogne aprÃĻs avoir, pendant de longs mois, fustigÃĐ la ÂŦdÃĐmocratisation culturelleÂŧ au nom de sa chÃĐtive petite notion de ÂŦculture pour chacunÂŧ. On ne trouvera ÂŦnul changement de paradigme, nul dÃĐsengagement dans les politiques qui ont ÃĐtÃĐ conduites sous ma responsabilitÃĐÂŧ, insiste-t-il sans craindre de falsifier les faits, de se renier, et de dÃĐcrÃĐdibiliser plus encore sa parole.
Pour tenter de se donner une ÃĐpaisseur à laquelle personne ne croit, pas mÊme son propre camp politique, FrÃĐdÃĐric Mitterrand se prÃĐsente donc comme lâinventeur dâun juste milieu, dâune troisiÃĻme voie: ÂŦEntre une dÃĐrÃĐgulation et le Tout-Ãtat, il y a une place pour la politique culturelle que jâai construite, pas à pas, avec pragmatisme et rÃĐsolutionÂŧ.
Mais cette place quâil revendique est une fiction politique destinÃĐe, dâune part, à faire oublier quâil est lâacteur et la caution dociles dâune politique de ÂŦdÃĐrÃĐgulationÂŧ systÃĐmatique de la culture, et, dâautre part, à dÃĐvaluer les propositions de Martine Aubry en les assimilant à de lâÂŦÃĐtatisme dâun autre ÃĒgeÂŧ.
La question des moyens de la culture mÃĐrite mieux quâune dÃĐbauche de slogans et de stÃĐrÃĐotypes, mieux que des fanfaronnades dÃĐrisoires. Dâautant plus quâà la proposition dâaugmenter le budget du ministÃĻre de la Culture est souvent opposÃĐe une sorte de rÃĐalisme qui voudrait sacrifier la culture sur lâautel de la dette: rÃĐduire les dÃĐficits au lieu de les creuser en finançant la cultureâĶ
Il sâagit ÃĐvidemment là dâune conception de la culture comme activitÃĐ superflue, de second ordre, voire frivole: socialement stÃĐrile et ÃĐconomiquement improductive. Une sorte de divertissement rÃĐservÃĐ aux pÃĐriodes fastes. En aucun cas une prioritÃĐ publique, un chapitre majeur de lâaction gouvernementale exigeant une partie nÃĐcessairement significative du budget de lâÃtat. En aucun cas, non plus, une force pour affronter diffÃĐremment les vicissitudes du monde.
Le ministre nâÃĐchappe pas à cette conception vulgaire qui oppose la culture aux coÃŧts de la culture. A lâen croire, la politique culturelle se scinderait en deux moments successifs et distincts: celui, ÂŦdâabord, du soutien à la crÃĐation, à lâidÃĐe de lâart, de la beautÃĐ et de leur mise à disposition à lâensemble des citoyensÂŧ; et celle, ÂŦaprÃĻsÂŧ, de la logistique, ÂŦlâargent ne servant quâà lubrifierÂŧ (LibÃĐration, 19 juil. 2011).
Eh bien non! La culture, la crÃĐation, la beautÃĐ ne sont pas seulement des questions dâidÃĐes, comme le voudrait la trÃĻs archaÃŊque conception idÃĐaliste qui sÃĐpare les idÃĐes et les choses, et considÃĻre les secondes comme de pÃĒles rÃĐpliques des premiÃĻres.
Au contraire, les Åuvres ne prÃĐcÃĻdent pas les conditions de leur rÃĐalisation. Lâart et la culture sont des activitÃĐs de lâintelligence manuelle, sensible, intellectuelle, et toujours technique, des individus et des peuples. En art, en danse, en musique, en littÃĐrature, et bien sÃŧr en architecture, la crÃĐation est trÃĻs directement tributaire de ses conditions matÃĐrielles dâexercice. Car, contrairement à des conceptions romantiques poussiÃĐreuses (dâun ÂŦautre ÃĒgeÂŧ), auxquelles le ministre semble bien croire, la crÃĐation est in-sÃĐ-pa-ra-ble-ment et si-mul-ta-nÃĐ-ment une question dâesprit et de sensibilitÃĐ autant que de corps et de matiÃĻre. La ÂŦbeautÃĐÂŧ ne prÃĐcÃĻde ni la matiÃĻre, ni les conditions de production des Åuvres.
Lâargent nâest pas un ÂŦlubrifiantÂŧ accessoire de la crÃĐation, il en est la condition de possibilitÃĐ sous la forme dâateliers, de temps de travail et de vie, dâÃĐchanges, de voyages, de matÃĐriaux, dâoutils, de musÃĐes, de publications, de supports de diffusion (y compris internet!), de personnels, etc.
Quant aux moyens matÃĐriels et humains quâelle requiert, la crÃĐation en art ne diffÃĻre en aucune maniÃĻre des crÃĐations scientifiques, industrielles, voire sportives.
Câest à la collectivitÃĐ publique nationale, rÃĐgionale et locale plutÃīt quâau secteur privÃĐ quâil incombe dâassurer un accÃĻs ÃĐquitable à ces moyens de crÃĐer, parce quâil sâagit-là dâune question de civilisation qui engage la dÃĐmocratie.
On connaÃŪt lâantienne contre ledit ÂŦart-subventionnÃĐ, art-officiel, art-aux-ordresÂŧ auquel est opposÃĐ lâart privÃĐ, libre, fÃĐcond, etc. Or, le massacre du secteur public de lâart et de la culture (notamment) auquel on assiste actuellement confirme que le secteur privÃĐ ne comble pas sous la forme ÂŦmÃĐcÃĐnatÂŧ, en France du moins, les dÃĐsengagements des collectivitÃĐs publiques, en particulier de lâÃtat â ce nâest dâailleurs pas son rÃīle, et de devrait pas lâÊtre.
La question majeure dâaujourdâhui nâest donc pas de privatiser le secteur public de la culture (comme le fait la droite), mais de le dÃĐmocratiser (comme ne le fait pas la gauche), afin que les conditions de la crÃĐation soient ÃĐquitablement rÃĐparties par des dÃĐcisions publiques, transparentes, prises esthÃĐtiquement (et non politiquement) par des instances adaptÃĐes.
Martine Aubry a raison de prÃĐconiser une augmentation significative du budget du ministÃĻre de la Culture, et de crÃĐer un nombre non moins significatif de postes en direction des jeunes. Elle se dÃĐmarque ainsi heureusement de la politique actuelle.
Mais cela ne suffit pas. Un immense chantier sâouvre à elle, à lâintÃĐrieur mÊme de son propre camp. Il sâagit de libÃĐrer la culture des clientÃĐlismes et intÃĐrÊts de toutes sortes qui lâannexent doublement à leur profit: dans lâattribution des moyens, et dans la rÃĐcupÃĐration des manifestations produites.
Il sâagit, en dâautres termes, de retirer aux ÃĐlus de tous bords le privilÃĻge exorbitant de gÃĐrer la culture quâils abordent gÃĐnÃĐralement de façon platement politique, donc inadÃĐquate.
Lâenjeu consiste donc à inventer une nouvelle forme de dÃĐmocratie qui ne serait pas seulement culturelle, mais esthÃĐtique. Une dÃĐmocratie dans laquelle les dÃĐcisions nâappartiendraient pas seulement à lâarbitraire des politiques ou des technocrates, mais seraient ouvertes aux dÃĐbats et apprÃĐciations des citoyens et des crÃĐateurs.
AndrÃĐ RouillÃĐ
Lâimage accompagnant lâÃĐditorial nâest aucunement lâillustration du texte. Ni lâartiste, ni le photographe de lâÅuvre, ni la galerie ne sont associÃĐs à son contenu.

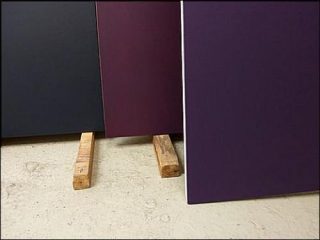
 parisART sur Instagram
parisART sur Instagram