Philippe et FrÃĐdÃĐrique Valentin soutiennent des artistes comme Boris Achour, Pierre Ardouvin, VÃĐronique Boudier, Franck David, Laurent Grasso, Mathieu Mercier, Nicolas Moulin, Simon Moretti, Jean-Michel Sanejouand, Veit Stratman. Ils exposent jusqu’au 29 novembre, leur premier artiste ÃĐtranger, Simon Moretti.
GÃĐrard Selbach. Vous aviez un stand à la Fiac 2003. Depuis quand participez-vous à cette foire ?
Philippe Valentin. Cela fait cinq ans, et c’est la premiÃĻre annÃĐe oÃđ nous avons un stand en dehors de Perspectives. Nous avons participÃĐ Ã Perspectives pendant trois ans, puis une annÃĐe oÃđ le secteur Perspectives n’existait pas vraiment en tant que tel, mais oÃđ il y avait dÃĐjà une aide de la Fondation Cartier pour un secteur ÂŦ Jeune CrÃĐation Âŧ.
Quelles sont les principales raisons de votre prÃĐsence à la Fiac ?
Pendant deux ans de suite, nous avions fait un ÃĐvÃĐnement qui ÃĐtait parallÃĻle à la Fiac, organisÃĐ par Lise Toubon, qui se passait dans le XIIIe arrondissement. La premiÃĻre fois, nous ÃĐtions à Austerlitz, et la deuxiÃĻme fois, comme nous n’avions pas pu avoir Austerlitz, elle avait trouvÃĐ un lieu dans le XIIIe. à cette ÃĐpoque, tout le monde disait que la Fiac devait arrÊter pour laisser la place à une foire plus jeune et dynamique, et je faisais partie de ces gens-là . Et comme il ne s’est rien passÃĐ, et que deux initiatives sont tombÃĐes à l’eau, nous avons dÃĐcidÃĐ de rentrer dans la Fiac et de tenter de la rÃĐformer de l’intÃĐrieur.
Et maintenant, quels sont vos objectifs et motivations ?
Quand j’ai commencÃĐ, il y a cinq, six ans, j’ai envisagÃĐ la Fiac comme une page de pub. C’est pourquoi, à chaque fois, je faisais un one-man show avec un artiste, souvent trÃĻs jeune, trÃĻs peu connu. Oui, pour moi, le stand ÃĐtait une page de pub. C’ÃĐtait le moyen de montrer des artistes, c’ÃĐtait un stand-expo et un stand quand mÊme. Et je demandais à mes artistes d’avoir un vrai projet par rapport au stand.
Cela signifie-t-il que vous jouez le rÃīle de producteur ou que vous orientez leur travail ?
Ce qui se passe, c’est que je dis à mes artistes : ÂŦ Voilà , je fais une expo à telle date Âŧ, et ils me proposent des projets. Je crois que, dans ma carriÃĻre, j’ai dÃŧ refuser un seul projet, pas plus. Donc, depuis dix ans, les artistes font exactement ce qu’ils veulent. Le cadre d’une foire est un peu diffÃĐrent d’un cadre d’exposition classique. Mais, malgrÃĐ tout, aprÃĻs leur avoir dit que ce n’ÃĐtait ni une galerie, ni un lieu classique comme un centre d’art, que c’ÃĐtait un lieu marchand, que les gens venaient voir des choses à acheter, mais aussi, des œuvres et des artistes, une fois qu’ils savaient que les donnÃĐes n’ÃĐtaient pas exactement les mÊmes que dans un centre d’exposition classique, ils faisaient ce qu’ils voulaient. Ils avaient carte blanche pour faire le stand. Et moi, je produisais les piÃĻces en consÃĐquence, en fonction de ce que les artistes me demandaient.
Selon quels critÃĻres choisissez-vous l’artiste ?
Je dirais que c’est l’artiste que l’on attend à ce moment-là . Parfois, je me suis trompÃĐ. Quand j’ai prÃĐsentÃĐ Nicolas Moulin à la Fiac, il y a trois ans, tout le monde est passÃĐ sur mon stand en disant que c’ÃĐtait trÃĻs beau, et personne ne m’a rien achetÃĐ. J’ai fait zÃĐro franc à cette Fiac. Et aujourd’hui, tout le monde s’arrache ses photos. Quand je les montre, je les vends. Simplement, c’ÃĐtait trois ans trop tÃīt. Nicolas Moulin n’ÃĐtait pas dans une position suffisamment ÃĐtablie pour qu’il y ait une sorte de dÃĐsir : ce cÃītÃĐ plastique, trÃĻs beau, leur faisait peur par rapport à ce que j’avais prÃĐsentÃĐ avant, qui ÃĐtait plus bricolÃĐ, ÂŦ destroy Âŧ. Il s’agit de sentir les attentes de mes collectionneurs, des institutionnels, et de me dire : ÂŦ C’est le bon moment pour mettre en avant cet artiste Âŧ.
Vous avez donc en tÊte un profil de collectionneur ou de conservateur qui serait susceptible d’Être intÃĐressÃĐ…
Oui, exactement, une sorte de cible.
Pouvez-vous dresser un portrait type de collectionneur ?
Non, c’est difficile. à chaque artiste correspond un type de collectionneur. Certains vont acheter des œuvres trÃĻs diffÃĐrentes qui n’ont rien à voir. C’est le mystÃĻre de la conscience individuelle et humaine qui fait la collection. Chacun crÃĐe des liens comme il veut. Quand je parle d’objectifs ou de cibles, c’est que je sens que certains ne sont pas loin d’Être intÃĐressÃĐs par le travail de tel ou tel artiste, et que, en procÃĐdant à cet appui et avec la page de pub que reprÃĐsente la Fiac, une dynamique est crÃĐÃĐe. Ãa marche ou ça ne marche pas, comme avec une mayonnaise. Avec Nicolas Moulin, je m’ÃĐtais trompÃĐ ; avec d’autres, j’ai mieux rÃĐussi.
Votre offre correspond donc à une demande latente de certains collectionneurs. Vous sentez qu’elle est là , sous-jacente …
Exactement. L’artiste produit son travail, et j’essaie de faire le petit truc qui fait avancer les choses.
Vous parvenez à cette dÃĐcision en faisant une ÃĐtude de l’ensemble du marchÃĐ de l’art ou de la production de vos artistes ?
Non, en fait, cela reprÃĐsente un an de travail. Mes artistes ont dÃĐjà rÃĐflÃĐchi à l’annÃĐe prochaine et j’ai dÃĐjà pensÃĐ au stand que je ferai. C’est simplement basÃĐ sur ce que je ressens, sur ce qui se passe autour de mes artistes, sur les propositions qu’ils reçoivent, sur le nombre de dossiers que j’envoie de tel ou tel artiste à tel moment. Je sais alors que là il y a des attentes, des demandes de la part de collectionneurs qui veulent voir de nouvelles piÃĻces. L’entonnoir se resserre, et je me dis : ÂŦ C’est celui-là que je dois emmener, c’est pour lui que ce sera le plus utile Âŧ.
Vous venez de parler des collectionneurs. Quel rÃīle jouent les conservateurs et les institutionnels dans l’ÃĐvolution des artistes que vous exposez ?
Ils permettent de faire des expositions. Quand un lieu comme Transpalette à Bourges, un lieu alternatif, propose à Nicolas Moulin de faire une installation, et qu’il fait une œuvre in situ, une sorte de bunker incroyable, cela lui donne les moyens de rÃĐaliser une œuvre et de passer un stade dans son travail, car il n’a jamais fait cela auparavant. Les lieux institutionnels montrent le travail des artistes et leur permettent d’aller plus loin, et aussi de faire le point sur l’ÃĐvolution de leur œuvre.
Comment jugez-vous la Fiac 2003 ? Est-ce un bon cru ?
Pour moi, cela a ÃĐtÃĐ une Fiac exceptionnelle. Je n’ai jamais autant vendu de ma vie à la Fiac. Pour ne pas mentir, j’ai fait quatre ans de one-man show. Et, cette annÃĐe, j’ai eu un stand plus classique, plus grand, plus dans le secteur Perspectives et j’ai fait un group show. Donc, à partir du moment oÃđ l’on ne met pas toutes ses billes dans le mÊme sac, on a plus de chance de tenter diffÃĐrents collectionneurs ou institutions, et donc plus de chance de gagner de l’argent. J’ai fait un chiffre d’affaires tout à fait consÃĐquent. Je pense que la Fiac a ÃĐtÃĐ parfaite, mais dans les conditions que je viens d’indiquer. Mais, ÃĐgalement, globalement, je ne pense pas que cela a ÃĐtÃĐ une mauvaise Fiac. Mais, c’est sÃŧr, je suis trÃĻs enthousiaste, car j’ai beaucoup vendu.
La Fiac ÃĐvoluerait-elle dans le bon sens ?
Elle n’ÃĐvolue pas dans le bon sens. On a plutÃīt fait un pas en retrait par rapport à l’annÃĐe derniÃĻre oÃđ de jeunes galeries amÃĐricaines et anglaises ÃĐtaient prÃĐsentes. Ce que je souhaite, c’est que la Fiac devienne une foire immanquable, une sorte de locomotive. D’ailleurs la presse s’est fait l’ÃĐcho du fait que certains ont prÃĐfÃĐrÃĐ aller à la Frieze plutÃīt qu’à la Fiac. Mais, malgrÃĐ tout, avec tous les problÃĻmes causÃĐs par les autres foires, on s’en est bien sorti, et le niveau n’ÃĐtait pas si mauvais que cela. Il y avait de trÃĻs bons stands. Je crois ÃĐgalement que toutes ces attaques ont favorisÃĐ le commerce.
Voulez-vous dire que les gens sont venus exprÃĻs ?
Les gens sont venus agacÃĐs et se sont dit : ÂŦ Eh bien non, la Fiac est trÃĻs bien. Il n’y a pas de raison de casser cette Fiac qui finalement nous propose des choses de qualitÃĐ. Nous allons acheter Âŧ. Je sens que des collectionneurs ont mis la main au portefeuille en pensant : ÂŦ Il ne faut pas que la Fiac disparaisse et que ce soit un enterrement. Elle doit rester un ÃĐvÃĐnement parisien important. Puisqu’elle est attaquÃĐe, nous allons la dÃĐfendre Âŧ.
Une des critiques a ÃĐtÃĐ de dire que la Fiac est trop franco-française, pas assez internationale …
Oui, c’est vrai, elle reste franco-française. C’est pourquoi, l’an dernier, cette ouverture ÃĐtait trÃĻs bien. Emmanuel Perrotin avait beaucoup travaillÃĐ pour que de jeunes galeries amÃĐricaines et anglaises viennent. Il a quittÃĐ le comitÃĐ de sÃĐlection. J’espÃĻre que son remplaçant aura les reins solides pour faire revenir ces galeries et pour rÃĐflÃĐchir à la date de la Fiac. C’ÃĐtait trop proche de la Frieze, encore que ce sont les Anglais qui sont venus se coller à la Fiac pour l’embÊter et prendre date. C’est une entreprise commerciale. Reed-OIP [ndr : organisateur de la Fiac] doit rÃĐflÃĐchir à la façon de rÃĐagir. Car je pense que, s’ils se contentent de ce qui s’est passÃĐ cette annÃĐe, nous risquons d’aller au bouillon. Maintenant, et j’ai reconnu que j’avais trÃĻs bien vendu cette annÃĐe, nous risquons de devenir un petit salon parisien franco-français qui va de moins en moins nous intÃĐresser. Je suis un des premiers à penser qu’il faut une foire d’art contemporain en France, que c’est trÃĻs important par rapport aux critiques sur l’absence de collectionneurs que le marchÃĐ français reçoit constamment. Il n’empÊche que L’Autruche de Mauricio Cattelan est dans une collection française. Mais personne ne dit qu’il y a des collectionneurs français importants. Il faut dÃĐfendre ce marchÃĐ en faisant venir des gens de l’extÃĐrieur pour leur prouver que nous avons des choses à montrer. Je crois aussi que les institutions et l’Ãtat doivent rÃĐflÃĐchir à leur politique d’achat, c’est-à -dire d’acheter à des galeries ÃĐtrangÃĻres pendant la Fiac et non en dehors. C’est le moment de marquer le coup et d’acheter une piÃĻce qui les intÃĐresse pendant la Fiac. On dit : ÂŦ Oui, les musÃĐes vont acheter à la Frieze Âŧ. En France aussi, nous avons des musÃĐes qui acquiÃĻrent de l’art ÃĐtranger. Donc, qu’ils le fassent au bon moment, symboliquement pendant la Fiac pour leur montrer qu’ils ont intÃĐrÊt à venir à la Fiac. J’exagÃĻre peut-Être un peu, mais c’est pour la dÃĐmonstration.
Participez-vous à d’autres foires ?
Je vais à Turin dÃĐbut novembre, pour la deuxiÃĻme annÃĐe. Une petite foire, mais intÃĐressante, car de grosses galeries y vont et cela draine de gros collectionneurs italiens. Et puis, c’est la pÃĐriode de la truffe blanche, donc une pÃĐriode sympathique. Ensuite, je vais participer pour la premiÃĻre annÃĐe à la Foire de BÃĒle. Pendant quatre ans, j’ai fait la foire annexe qui s’appelle la Liste, et je suis allÃĐ une fois à l’Arco, à AthÃĻnes. Aujourd’hui, j’ai envie de me concentrer sur la Fiac et sur BÃĒle, peut-Être un jour les Ãtats-Unis qui restent chers. Il faut ajouter les frais de transport et de logement trÃĻs importants.
La Frieze ne vous tente pas ?
Je suis allÃĐ voir la Frieze le jour du vernissage. C’est ÃĐvident que les collÃĻgues qui ont des artistes dans le top ten, ont vendu. Ceux qui n’ÃĐtaient pas dans le top ten, ont souffert. Il ne faut pas se leurrer, ce n’est pas la Fiac contre la Frieze. Il n’y a pas plus de gens qui vont acheter. Ils ont fait un ÃĐvÃĐnement extrÊmement mondain, ÂŦ fashion Âŧ, et toute une partie de l’art est en train de tomber là -dessus. Je pense qu’à Paris on peut faire autre chose et le faire bien.
Vous occupez-vous d’artistes ÃĐtrangers autre que Simon Moretti que vous prÃĐsentez en ce moment ?
Non, c’est le premier artiste ÃĐtranger avec John Armleder que j’expose. Si on regarde la liste de mes artistes, la plupart sont français, vivant à Paris. Il y a un Allemand, Veit Stratman qui vit à Paris depuis quinze ans. Je suis donc une galerie franco-française. Aujourd’hui, je me dis que j’ai fait un gros travail avec une gÃĐnÃĐration d’artistes à Paris, il faut maintenant qu’ils se mixent avec d’autres gens pour que des liens puissent s’ÃĐtablir. La premiÃĻre expÃĐrience est celle de Simon.
Pourquoi lui ?
C’est une rencontre. Il est venu à la Foire de Turin. Il voulait m’emprunter des piÃĻces de Mathieu Mercier pour une exposition dont il est curateur pour des lieux à Londres. Comme il est artiste, je lui ai demandÃĐ si je pouvais voir son travail. Il m’a montrÃĐ son travail et son book. Nous nous sommes regardÃĐs deux minutes avec FrÃĐdÃĐrique (Valentin), et nous l’avons invitÃĐ Ã participer au group show Format de fÃĐvrier dernier. Ãa s’est bien passÃĐ, nous nous sommes bien entendus, et nous lui avons demandÃĐ s’il ÃĐtait intÃĐressÃĐ par une expo personnelle. Il a invitÃĐ John Armleder, puisque beaucoup de ses piÃĻces sont soit des emprunts, soit des citations d’autres travaux. Simon voulait que, dans ses citations, il y ait une œuvre rÃĐalisÃĐe par quelqu’un d’autre qui vienne comme un dÃĐcor de ses piÃĻces.
Vous semblez apprÃĐcier chez cet artiste sa production trÃĻs ÃĐclectique et ses mÃĐdiums trÃĻs divers…
J’aime cela chez tous mes artistes. Peu de gens ne font que de la photo, de la peinture ou de la vidÃĐo. J’aime les gens qui touche à tout. Quand un mÃĐdium est important pour un sujet, c’est ce mÃĐdium qui est utilisÃĐ. Cela caractÃĐrise bien les gens avec qui je travaille.
Donc, en ce moment vous Êtes en quÊte d’artistes d’autres pays ou peut-Être mÊme amÃĐricains ?
Oui, en ce moment, je prÃĐpare une expo de groupe oÃđ j’ai invitÃĐ un artiste amÃĐricain Joe Scanlan, de la gÃĐnÃĐration de Pierre Huyghe, qui a beaucoup baroudÃĐ avec eux, et qui a fait une piÃĻce autour de la nuit. Il fait partie d’une bande d’artistes trÃĻs peu vus en France. Je suis son travail depuis longtemps, et je l’ai invitÃĐ. Avec son tempÃĐrament amÃĐricain, il a voulu faire une expo de groupe avant de faire une expo personnelle. A priori, ce sera lui qui sera le curateur de l’exposition : des œuvres amÃĐricaines, que des choses qu’on ne peut pas comprendre aux Ãtats-Unis. On ne sera pas dans de l’art du style Jeff Koons, mais plus dans des choses petites et dÃĐlicates, et il veut un titre trÃĻs pro-amÃĐricain pour se moquer de l’esprit amÃĐricain.
Vous venez de faire rÃĐfÃĐrence aux artistes amÃĐricains, sentez-vous des diffÃĐrences entre les marchÃĐs de l’art amÃĐricain et français ?
Quand je suis à New York, je ne comprends mÊme pas. Je trouve la scÃĻne amÃĐricaine attristante de qualitÃĐ, formelle et plastique. Ou c’est de la superproduction comme Jeff Koons, ce qui correspond à une mentalitÃĐ amÃĐricaine. Jeff Koons est intÃĐressant dans l’histoire de l’art par rapport à ce que sont les Ãtats-Unis. Mais je ne pense pas que ce soit la seule voie amÃĐricaine. Les autres voies, plus dÃĐlicates, plus intelligentes et sensibles, n’ont pas vraiment de place. Donc, premiÃĻrement, je suis plutÃīt dÃĐçu. DeuxiÃĻmement, un de mes artistes travaille avec une galerie amÃĐricaine à New York. Il est ÃĐvident que nous n’avons pas la mÊme façon de travailler. C’est difficile pour un garçon comme Mathieu (Mercier) de s’adapter. Son galeriste est tellement pro-amÃĐricain que cela en est insupportable. Il ne comprend pas pourquoi il ne vient pas s’installer à New York parce que c’est le plus beau pays du monde et que c’est là qu’il y a de l’argent.
C’est une offre tentante, non ?
Pour l’instant, il prÃĐfÃĻre vivre soit à Paris, soit à Berlin oÃđ il se sent mieux. Mathieu est trÃĻs europÃĐen dans sa façon de vivre et de travailler.
Entretien rÃĐalisÃĐ en octobre 2003 par GÃĐrard Selbach pour paris-art.com.
Lien
Le site de la galerie Chez Valentin





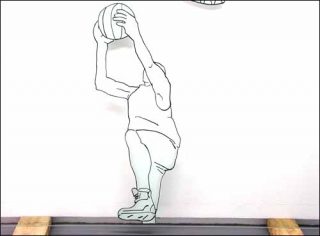


 parisART sur Instagram
parisART sur Instagram