Interview
Par Pierre Évariste-Douaire
paris-art.com ouvre ses colonnes à une longue série d’interviews consacrée aux artistes urbains. La succession des portraits permettra de découvrir les visages et les pratiques de ces artistes qui transforment la ville en galerie à ciel ouvert.
Paella Chimicos a commencé à s’afficher dans la rue dès 1985. En marge des palissades du Louvre et de Beaubourg, il a très vite opté pour la discrétion des gouttières. Grâce aux presses sérigraphiques de l’École des Beaux-Arts, les mêmes que celles de Mai 68, il a pendant cinq ans collé ses petites affiches au cœur de Paris. Depuis il se sert de la rue pour chroniquer son quotidien. Ses affiches sont autant des tracts que des éditos, elles lui permettent de toucher directement les gens.
Pierre-Évariste Douaire. Ta première expérience avec la rue s’est déroulée sur les palissades du Louvre au début des années 1980.
Paella. J’étais aux Beaux-Arts avec une bande de copains, et c’est à ce moment là qu’il y a eu le grand chantier du Louvre et des tas de palissades autour de Beaubourg. Je me suis joint au groupe qui y allait, j’étais déjà assez actif au sein de l’École des Beaux-Arts. Il y avait un besoin de s’exprimer sur des surfaces plus grandes. Sur les palissades, ce qui était un peu marrant, c’est que les gens se répondaient. Il y avait plusieurs groupes qui passaient, le soir ou le jour, pour essayer de prendre des territoires. C’est à ce moment que j’ai commencé à voir que la rue pouvait créer d’autres formes de dialogues. C’était autant une prise de position que de terrain, c’était autant manifester des revendications que prendre une place et une surface dans la ville.
Sur les palissades tu faisais de la peinture ?
C’est ça. Je faisais sur des palissades ce que je faisais par ailleurs en peinture.
Est-ce que tu laissais ton numéro de téléphone sur tes peintures pour nouer des contacts, comme cela se faisait à l’époque ?
J’ai mis mon numéro de téléphone, mais peut-être deux ans après avoir commencé mes affiches, pour voir si les gens étaient curieux de savoir qui se cachait derrière. Cela n’a pas débouché sur beaucoup d’appels. L’affiche n’a pas trouvé un public intéressé par ce que l’on pourrait vendre. Mes affiches ont toujours été faites dans une démarche de gratuité, elle ne renvoient pas forcément à ma peinture ou à mon art. L’idée de gratuité et de geste vers le public était présente dans mon travail à ce moment-là .
Par ce travail en extérieur, que recherchais-tu ?
Au début, j’étais dans une optique d’expression. Par la suite, quand j’ai envisagé la rue comme un mode de travail, j’ai opté pour l’affichage. Il y avait dans la rue plusieurs personnes qui avaient déjà acquis un langage particulier, Mesnager, Speedy Graphito, Miss. Tic, donc j’ai voulu me démarquer d’eux. Ma formation est proche de celle d’un graphiste, je suis un publicitaire quelque part, en plus aux Beaux-Arts j’étais dans l’atelier de sérigraphie, celui qui avait servi pour Mai 68. Tout ça m’a donné envie de trouver un langage propre, qui ne soit pas un appel au public directement.
Je connais tes affiches sur les gouttières, à l’époque tu utilisais déjà le même support ?
Oui, quand j’ai commencé en 1985 j’en ai posé sur les gouttières. En marge de ça j’en ai posé dans le métro, puis sur les culs des bus, j’ai fait quelques campagnes comme ça. Mais j’intervenais principalement sur les gouttières.
Tu as été le premier à investir ce mobilier urbain ?
Oui, enfin le premier de cette génération. Quand je collais sur les gouttières, il y avait des petites annonces pour les cours de bodybuilding avec un monsieur-muscle dessus. C’était un espace intermédiaire, c’était entre les affiches publicitaires et les affiches sauvages qui nécessitent des endroits assez grands. Mes affiches font une petite dizaine de centimètres, ça me permettait de me mettre dans des endroits intermédiaires comme des boîtes électriques, des gouttières, des conduits d’évacuations, autant d’endroits qui sont en marges.
Ces endroits sont moins nettoyés, ils semblent n’appartenir à personne ni aux riverains, ni à la municipalité. C’est pourquoi les affiches vivent plus longtemps que dans un autre endroit, le rythme des affichages a pris son rythme naturel. Au bout d’un certain moment, il y a eu une certaine accumulation de ces affichettes. Les gens qui les appréciaient notaient surtout qu’elles n’étaient pas mises en évidence, un jeu de piste s’établissait entre les différents arrondissements de Paris.
C’était un acte gratuit d’aller coller dans la rue, c’était en marge de ton travail de peintre ?
En 1985 j’ai entamé un travail en peinture et j’ai voulu trouver une forme qui vienne de la peinture, mais qui n’en soit pas une traduction directe. Ce que j’avais à dire dans la rue était différent de ce que j’exprimais dans ma peinture. J’ai vraiment adapté mon travail d’atelier à la rue. Je n’ai gardé que ce personnage à la tête étrange qui pouvait représenter tout le monde et personne à la fois. Parfois je pouvais caricaturer une personne en particulier, mais le plus souvent ce personnage oscillait entre l’incognito et l’universel. Je pouvais lui donner plusieurs étiquettes qu’elles soient politiques ou sociales. Le seul élément pictural qui se retrouve dans mes affiches c’est cette tête en forme de spirale, mais en lui-même le personnage ne représentait pas ce que je faisais en peinture à ce moment-là . Il n’avait pas les propriétés élastiques du personnage que je peignais alors.
Et les gens l’ont appelé Paella immédiatement ?
Ils l’ont appelé Paella parce qu’il y avait écrit Paella sur les affiches, tout simplement, un peu comme on nomme un Picasso ou un Matisse. Le nom s’est collé à au personnage puisqu’on ne savait pas comment l’appeler. Dans la rue on ne savait pas ce que représentait cette affiche, si c’était un restaurant ou un groupe de musique.
Mais Paella c’est ton nom ?
C’est l’anagramme de mon nom. Au début c’était Paella Chimicos et ensuite c’est devenu Paella tout court. Mais Paella c’était le nom que j’utilisais dans mes peintures, c’était tout naturel de le retrouver sur les affiches, cela simplifiait les choses et pour le public cela résonnait de façon très énigmatique et de très exotique à la fois.
La rue, ça te permettait de te défouler, de faire quelque chose de plus ludique que dans ta peinture ?
La rue me permettait surtout d’aller vers le public. A cette époque je faisais des performances, on allait dans les galeries, dans des centres culturels, on essayait de toucher le plus grand nombre, on voulait faire voir de la peinture au public le plus large. Je voulais aussi m’adresser aux gens qui ne sont pas intéressés par la peinture, ils m’intéressent aussi, j’avais envie de leur communiquer des choses. C’est pour cette raison que je choisissais des arrondissements à proximité des galeries, mais aussi des quartiers qui étaient des points de passage et qui drainaient une population très contrastée : Saint-Germain-des-Près, Beaubourg, le Marais et les Halles concentraient pour moi une mixité.
Tu utilisais quel type de support pour tes affichages ?
Du papier journal de base, un blanc qui jaunit par la suite. C’était du papier que j’arrivais à trouver gratuitement ou que je trouvais, le moins cher possible pour pouvoir en produire le maximum.
Tu imprimais tout ça aux Beaux-Arts ?
En 1985 j’étais dans l’atelier de sérigraphie et j’utilisais les machines de l’école. Par la suite j’ai continué à les utiliser. Pour ceux qui ne connaissent pas tellement cette technique, il s’agit de ce que faisait Warhol. Tu peux aussi bien faire des tee-shirts que les affiches de Mai 68. La photocopie a peut-être supplanté cette technique, parce qu’elle permet d’imprimer beaucoup plus vite et avec beaucoup moins d’efforts des centaines de feuilles. Par contre j’avais une qualité d’impression et un graphisme qui me satisfaisaient quand j’imprimais mon travail. Comme je collais moi-même mes affiches, je préférais avoir un résultat distinct de la facilité de la photocopie. Le travail sur la matière me semblait mieux convenir à ma démarche.
Ce travail tu l’as commercialisé, marouflé sur toile, tu as multiplié les supports ?
Non, justement, je considérais ce travail comme de l’affiche. 90% des affiches ont été collées dans la rue, mais c’est vrai qu’il en reste toujours un peu. Dans l’action le but était de les afficher, ensuite j’en ai montrées dans des expositions. Je n’ai pas cherché un débouché artistique à ce travail.
Mais par la suite est-ce que c’est devenu un moyen de communication, de faire ta pub, de montrer ta peinture ?
Dans mes affichages il y a toujours eu une façon de parler de moi aussi, d’annoncer mes expositions en cours. Je profitais de ce rythme d’affichage pour faire ma propre pub. L’auto-publicité était une donnée de mon travail. Aller vers les gens, vers le public, faisait aussi espérer un retour en échange en direction mon travail pictural. Mais peu de gens sont allés de mes affiches à ma peinture. J’ai conjointement toujours fait mon travail de peinture, j’ai toujours exposé dans des galeries, dans des espaces culturels.
Et à l’inverse, est-ce que les gens qui te connaissaient comme peintre ont été vers tes affiches ?
Travailler dans la rue fait partie de mon étiquette dans les galeries, je suis un peu estampillé « alternatif ». L’évolution de mon travail pictural correspond assez bien à mon travail dans la rue. Les gens des vernissages apprécient l’aspect urbain qu’il y a chez moi.
Tu as utilisé le mot de marge plus haut, et je sais que Cobra t’intéresse. Tu me fais penser, dans un genre différent, à Alechinsky qui travaille sur la bordure dans ses tableaux. Tes gouttières épousent les contours de la marge sociale, artistique et architecturale.
J’ai trouvé ma place dans la rue intuitivement alors que déjà beaucoup d’artistes avaient pris des territoires. Il y avait du monde dans la rue, qu’il fallait prendre un peu en contre-pied. Au lieu d’aller occuper les grands panneaux d’affichage, je préférais agir par touches discrètes. Mais cette stratégie est peut-être plus payante, elle touche peut-être plus les spectateurs attentifs des rues. Être le plus grand ou le plus vu dans la rue n’est peut-être pas la démarche la plus intéressante. Effectivement, la question de la marge s’est posée dans mon travail de peintre, et sur les questions de limite de la feuille et de la toile. Cobra est une référence parmi d’autres, mais pourquoi pas.
La référence à Ben est aussi quelque chose que j’ai lu te concernant.
C’est vrai que chez Alechinsky et Ben il y a un rapport entre l’écriture et l’image. Mais je n’ai jamais voulu être Ben parce que je m’exprime sur moins de domaines que lui mais peut-être de façon plus pertinente.
Tes affichages se sont déroulés de 1985 à 1990, mais j’ai vu ton travail depuis dans la rue.
Après cette période j’ai fait d’autres choses dans la rue. Je suis revenu aux affichettes à l’aide de strip composé de trois cases reprenant le modèle que l’on trouve dans la presse. J’ai cherché à mettre en situation les gens d’aujourd’hui, cela correspondait à un nouveau travail que j’avais commencé en peinture. Je tente toujours de faire un support qui soit particulier.
Ton travail sur les gouttières a de grandes ressemblances avec le dessin de presse, les caricatures.
Quand j’ai commencé j’ai regardé toutes les images qui associaient le texte : les affiches de cinéma, les affiches. J’ai par contre essayé de me différencier du dessin de presse puisque mes productions étaient destinées à la rue. Les codes des journaux m’intéressent mais je ne les ai pas utilisés puisque j’investissais d’autres espaces, cependant, le trait, la synthèse d’une scène sont des choses intéressantes. En peinture, j’utilise ces codes, mais d’une manière plus poussée. Ce qui me dérange dans le dessin de presse c’est la chute, c’est l’obligation du gag final qui évite la réflexion.
Au printemps 2004, dans le Marais j’ai croisé à nouveau tes affiches.
J’ai eu envie d’en coller à nouveau pour annoncer une exposition. Je les considère maintenant plus comme des tracts. J’imprime une sérigraphie que je distribue sous forme de tracts pour informer sur une expo. Ils conservent le petit format de quelques dizaines de centimètres, mais leur destin n’est pas d’être collés. Cela m’amusait de faire quelque chose dans la rue, surtout que je faisais plus de choses dans le métro.
Des cartes postales aussi.
Oui comme celle que je t’ai donnée et qui représente des détournements publicitaires dans le métro. Ce sont toutefois des actions plus subtiles et plus discrètes que celles menées par les équipes qui ont attaqué aux affiches du métro.
Comment as-tu réagi à cette vague ?
Moi, je travaillais dans le métro à mon échelle, j’étais tout seul, ça me prenait du temps pour faire toute une ligne. Quand ils sont arrivés sous terre, ils ont déclaré la guerre et ont déclenché des réactions répressives importantes. Mon travail s’est trouvé fragilisé par ces actions sauvages. Soit je pouvais être recouvert par eux, soit il y avait plus de flics dans le métro. Par contre, je suis allé voir ce qu’ils faisaient, j’ai même collé des trucs avec eux. Ces interventions ne sont pas très intelligentes, elles sont basées sur un rejet physique de la publicité. C’est pas forcément pertinent, mais ce qui les rend sympathiques c’est l’utopie de vouloir annihiler totalement la publicité, alors qu’elle est omniprésente. J’ai très vite abandonné le groupe que je suivais en me disant que ma démarche, si elle est plus laborieuse et plus limitée dans son impact médiatique, est plus intéressante. C’est dans sa visée qu’elle est plus intéressante, même si ce que je dis ne l’est pas forcément. Je tente de faire réfléchir les gens au lieu de les obliger à choisir un camp, les pour et les contre. Je préfère m’insinuer et faire les choses discrètement et au moins toucher quelques personnes. Par contre, c’était bien que ce type d’action arrive, mais c’était voué à l’échec.
J’ai toujours trouvé ces campagnes violentes et bêtes.
Il faut pas les voir comme des attaques portées à l’affiche, elles s’en prennent à la publicité en général et à la manipulation des esprits en particulier.
Tu exposes prochainement à la Nuts gallery.
Oui, dans le Marais, 37 rue Debelleyme, du 17 novembre au 31 décembre 2004. J’expose conjointement avec Arnaud Pagès, Esoj et Gugli: trois peintres et un sculpteur. L’expo s’intitule Nos super héros de tous les jours. On tente de savoir ce que chacun d’entre nous porte d’héroï;que en lui, les pouvoirs qu’il peut porter en lui.
Une semaine plus tard, les studios Pixar sortent sur grand écran un film d’animation sur le même thème non ?
Oui, ils sortent, la coï;ncidence est troublante, Les Indestructibles, et en plus il y a Superman alias Christopher Reeve qui meurt et tout et tout…
Ton site internet Palleachimicos.com sera prêt quand ?
Cela dépend de mon webmaster et de ma capacité à lui fournir tous les documents qu’il demande. Je ne sais pas encore. Dans quelque temps, tu veux dire à l’échelle humaine ? je pense vers le printemps 2005.


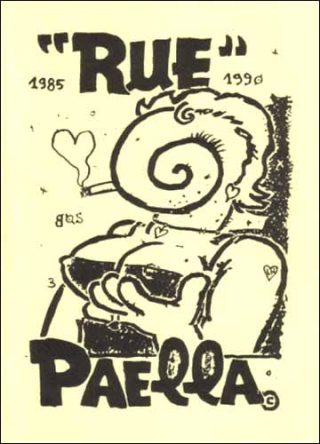

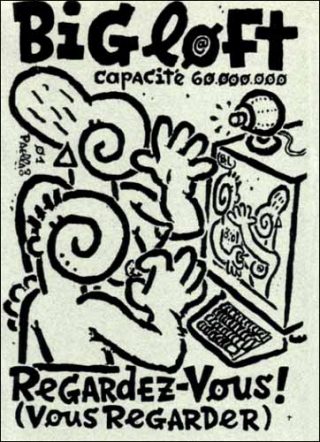


 parisART sur Instagram
parisART sur Instagram