— Éditeur : Frac Bourgogne, Dijon
— Année : 2002
— Format : 15 x 11,50 cm
— Illustrations : nombreuses, en couleurs et en noir et blanc
— Pages : 175
— Langues : français, anglais
— ISBN : 2-913994-04-0
— Prix : non précisé
L’objet a existe, je l’ai rencontré
par Emmanuel Latreille (extrait, pp. 7-13)
« Je rêve que je dors. »
Philippe Léotard
Au moment o√π il entre dans l‚Äôespace d‚Äôexposition, le spectateur ne voit √Ý peu pr√®s rien. Ou plus exactement, il ne per√ßoit que la surface blanche des murs, comme laiss√©e vierge de toute intervention. L√Ý o√π tr√®s g√©n√©ralement quelque chose se donne √Ý voir selon une mise en forme qui fait fond sur l‚Äô√©cran neutre des murs, on ne trouve d‚Äôabord, en d√©couvrant une exposition de Michael Ross, que l‚Äô√©tendue propre du lieu. Pr√©cisons : l‚Äôattente qui est g√©n√©ralement la n√¥tre lorsque nous visitons une exposition, est d‚Äôabord celle d‚Äôidentifier, √Ý plusieurs niveaux, certaines formes, que nous analysons ensuite en les d√©taillant ou en les mettant en relation les unes avec les autres. Les artistes minimalistes et conceptuels ont pouss√© dans ses plus radicales cons√©quences la logique du white cube, sur le fond duquel vient se d√©tacher une forme, parfois aussi simple qu‚Äôune ligne tendue dans l‚Äôespace (Fred Sandback) ou, sur les murs eux-m√™mes, la ligne noire de leur mesure horizontale ou verticale (Mel Bochner). La mise en √©vidence d‚Äôune gestalt dont l‚Äôarchitecture du lieu peut (et pour les artistes in situ : doit) √™tre partie prenante, d√©coule d‚Äôune conception positive de l‚Äôexposition issue des probl√©matiques de la modernit√© artistique. Un de ses enjeux principaux est de d√©velopper l‚Äôattention du spectateur aux divers aspects de la r√©alit√© qui l‚Äôentoure. Nombre d‚Äô≈ìuvres dites d‚Äô ¬´ installation ¬ª sont √©galement les enfants naturels de cette dimension de monstration de l‚Äôart et ¬´ l‚Äôaccrochage ¬ª d‚Äôune exposition, quels que soient par ailleurs les ≈ìuvres qu‚Äôelle pr√©sente, est de ce fait devenu un crit√®re exig√© de sa qualit√©. Une exposition contemporaine est ainsi jug√©e souvent selon sa lisibilit√©, c‚Äôest-√Ý-dire en fonction de la ma√Ætrise d‚Äôune organisation qui est, avant toute autre consid√©ration, une organisation de formes. Du coup, la disposition mentale qui, du c√¥t√© du spectateur, accompagne g√©n√©ralement l‚Äôabord d‚Äôune exposition r√©cuse ce qui, dans l‚Äôexercice courant de ses facult√©s perceptives, ne correspond pas √Ý une mise en ordre des choses qui se pr√©sentent continuellement √Ý lui : il contr√¥le surtout le balayage que son regard et son esprit exercent en permanence sur la diversit√© sans ordre du monde, de mani√®re partiellement inconsciente, et privil√©gie plut√¥t une concentration et une attention qui pr√©supposent des hi√©rarchies introduites dans l‚Äôimmense r√©servoir du visible. Ainsi dispos√©, il peut imm√©diatement commencer √Ý appr√©cier cette mani√®re de mise en sc√®ne qu‚Äôest l‚Äôexposition et se pr√©parer √Ý rendre un jugement, indice de son degr√© de satisfaction ou d‚Äôinsatisfaction.
Or c‚Äôest tr√®s exactement le contraire qui se passe lorsque l‚Äôon rentre dans une exposition de Michael Ross : rien ne s‚Äôoffre au regard (et par cons√©quent √Ý la conscience) qui puisse √™tre d‚Äôembl√©e un point d‚Äôappui pour lui, ou pour son d√©sir de formes ma√Ætrisables. Au contraire, l‚Äôabsence de choses nettement identifiables rend plus aigu, pendant un court instant o√π rien ne fait obstacle, son balayage de l‚Äôespace vide. S‚Äôil n‚Äôy a rien √Ý voir, il n‚Äôy a rien √Ý organiser. C‚Äôest comme si l‚Äôartiste mettait le spectateur face √Ý un √©cran blanc sur lequel il ne lui √©tait pas possible de faire une quelconque mise au point. Pourtant, la surface blanche des murs n‚Äôest pas absolument vierge. Des ombres, des taches de couleur ou des reflets lumineux proviennent √Ý l‚Äô≈ìil, sans qu‚Äôil puisse en identifier la source, mais qui indiquent sans doute possible une pr√©sence r√©elle de ¬´ choses ¬ª. En somme, la surface environnante de l‚Äôespace appara√Æt comme diversement modul√©e (plus que d√©coup√©e) par des pr√©sences non identifiables, et le regard, rendu impuissant par la distance qui le s√©pare d‚Äôelles, ne peut qu‚Äôaccompagner ces modulations ind√©chiffrables. En lieu et place d‚Äôune forme pos√©e sur un fond, le spectateur ressent donc comme une troublante h√©sitation entre l‚Äôindiff√©renciation g√©n√©rale du lieu, et l‚Äôamorce d‚Äôune diff√©renciation objective produite timidement par des r√©alit√©s fugaces. √Ä quelle autre image pourrions nous faire appel, pour pr√©ciser ce double mouvement de la perception, entre conscience et inconscience, que celle offerte par la surface de l‚Äôoc√©an, dont chaque cr√™te de vague renvoie √Ý l‚Äô≈ìil qui la parcourt une pointe de lumi√®re, donnant parfois le sentiment que quelque chose appara√Æt (¬´ Regarde, Jacques, une bo√Æte de sardines ! ¬ª) alors que d√©j√Ý la vague se creuse avant de dispara√Ætre ?
Le r√¥le de la lumi√®re est de fait extr√™mement important dans le cas des sculptures de Michael Ross : d√®s la premi√®re d‚Äôentre elles, en 1991, il utilise un d√© √Ý coudre m√©tallique parfaitement brillant. Les ≈ìuvres suivantes seront r√©alis√©es avec une infinit√© d‚Äô√©l√©ments m√©talliques r√©cup√©r√©s, puis des papiers ou des plastiques dot√©s des m√™mes qualit√©s luminescentes (papiers d‚Äôaluminium, feuilles de plastique d‚Äôemballages ou papiers glac√©s) viendront se joindre ou se substituer √Ý eux. Pour l‚Äôartiste, ce choix de mat√©riaux ¬´ m√©tallis√©s ¬ª r√©pond √Ý une certaine conception de l‚Äôhistoire de la sculpture dans laquelle il veut inscrire son travail, une tradition qui lui para√Æt impliquer l‚Äôusage de m√©taux (la sculpture, n‚Äôest-ce pas d‚Äôabord le bronze ?) et leur duret√© froide et r√©fl√©chissante. Ainsi, son ≈ìuvre la plus volumineuse a √©t√© r√©alis√©e cette ann√©e au moyen d‚Äôun millier de cuill√®res en fer inoxydable, dans le parc Sonsbeek √Ý Arnhem, aux Pays-Bas : enchev√™tr√©es les unes aux autres dans un talus de terre, ces cuill√®res figuraient une curieuse racine artificielle de plusieurs m√®tres de long qui, le soir surtout, renvoyait violemment les rayons du soleil couchant. La proposition constituait ainsi une mise en doute ‚Äî percutante ‚Äî de l‚Äôopposition des cat√©gories du naturel et du culturel. √Ä titre compl√©mentaire, les √©l√©ments en plastique, les mousses et les ficelles de toutes sortes sont pr√©sents dans le travail, introduisant ces couleurs plus vives qui, de loin, produisent pour l‚Äô≈ìil ces taches plus picturales qui semblent moduIer diversement la surface des murs. Malgr√© leur petite taille, les ≈ìuvres de Michael Ross disposent donc de tous les arguments pour capter notre attention flottante et pour, dans l‚Äôimmense √©tendue des murs o√π elles semblent comme √©gar√©es, infimes Radeaux de la m√©duse perdus dans l‚Äôoc√©an infini de la cr√©ation, nous attirer √Ý elles.
Et c‚Äôest ce qui advient en effet; mais le moment d‚Äôincertitude et de flottement √©prouv√© lors de l‚Äôentr√©e dans l‚Äôexposition, en raison de ce manque d‚Äôune forme diff√©renci√©e et stable offerte au tout premier regard, a d√©j√Ý mis le visiteur comme en retard. En se dirigeant vers les murs pour d√©crypter ses perceptions visuelles incertaines, il se trouve dans la situation d‚Äôavoir √Ý r√©cup√©rer un d√©calage, un √©cart, qui se serait inscrit dans sa propre vision. En effet il peut supposer qu‚Äôil a √©t√© vu plus t√¥t (plut√¥t) qu‚Äôil n‚Äôa lui-m√™me vu. (Nous verrons plus loin que ce sentiment est en fait objectivement fond√© sur ce que beaucoup de ces ≈ìuvres ¬´ repr√©sentent ¬ª.) Ce d√©calage implicite est confirm√© par le fait que le visiteur, d√®s qu‚Äôil a pu les localiser, se pr√©cipite vers les taches lumineuses ou color√©es pour les identifier. Nous pouvons remarquer alors qu‚Äô ¬´ il entre dans le tableau ¬ª ‚Äî mettons, pour un autre visiteur qui le suivrait ‚Äî alors m√™me qu‚Äôil pense √©chapper √Ý une situation inhabituelle et quelque peu d√©stabilisante, croyant alors qu‚Äôil va en finir vite avec l‚Äôind√©termination initiale. Mais il reste pris √Ý une sorte de pi√®ge, et ne le sait pas encore : malgr√© lui, il plonge vers des illusions de bou√©es. Voici pourquoi:
Les sculptures de Michael Ross mettent en ≈ìuvres diff√©rentes sortes d‚Äôobjets ou mat√©riaux trouv√©s. Par leurs petites dimensions, ces objets et mat√©riaux appartiennent √Ý des registres de la r√©alit√© auxquels nous n‚Äôaccordons pas fr√©quemment notre attention, m√™me si on peut √™tre s√ªr de les avoir fr√©quent√©s d‚Äôune fa√ßon ou d‚Äôune autre. Il s‚Äôagit en effet tr√®s souvent d‚Äô√©l√©ments d‚Äôobjets utilitaires, mais consid√©r√©s maintenant hors de leur contexte d‚Äôusage. Et, qu‚Äôon le soup√ßonne ou non, nos crit√®res de reconnaissance sont calibr√©s, autant du point de vue de la quantit√© (dans le monde de l‚Äôart comme dans la vie sociale, nous accordons spontan√©ment consid√©ration et respect √Ý ce qui tend vers le plus grand) que de celui de l‚Äôusage (d√®s que quelque chose est s√©par√© de sa fonction utilitaire, nous ne parvenons plus √Ý lui attribuer de sens). C‚Äôest pourquoi, ce que l‚Äôon √©prouve en approchant les ≈ìuvres de Michael Ross est assez comparable avec l‚Äôexp√©rience perceptive que Kandinsky rapporte comme ayant motiv√© sa d√©cision de passer √Ý l‚Äôabstraction. Nous citerons ici la description compl√®te de celle-ci puisque, en bien des points, elle permet de comprendre l‚Äô√©tonnement que produit le travail de Michael Ross :
¬´ ( … ) √Ý Munich, dans mon atelier, je restais sous le charme d‚Äôune vision inattendue. C‚Äô√©tait l‚Äôheure du cr√©puscule naissant. J‚Äôarrivais chez moi avec ma bo√éte de peinture apr√®s une √©tude, encore perdu dans mon r√™ve et absorb√© par le travail que je venais de terminer, lorsque je vis soudain un tableau d‚Äôune beaut√© indescriptible, impr√©gn√© d‚Äôune grande ardeur int√©rieure. Je restai d‚Äôabord interdit, puis je me dirigeai rapidement vers ce tableau myst√©rieux sur lequel je ne voyais que des formes et des couleurs et dont le sujet √©tait incompr√©hensible. je trouvai aussit√¥t le mot de l‚Äô√©nigme : c‚Äô√©tait un de mes tableaux qui √©tait appuy√© au mur sur le c√¥t√©. J‚Äôessayai le lendemain de retrouver √Ý la lumi√®re du jour l‚Äôimpression √©prouv√©e la veille devant ce tableau. Mais je n‚Äôy arrivai qu‚Äô√Ý moiti√© : m√™me sur le c√¥t√© je reconnaissais constamment les objets et il manquait la fine lumi√®re du cr√©puscule. Maintenant j‚Äô√©tais fix√©, l‚Äôobjet nuisait √Ý mes tableaux. ¬ª [Wassily Kandinsky, Regard sur le pass√© et autres textes 1912-1922, trad. de Jean-Paul Bouillon, Hermann √©diteurs des sciences et des arts, Paris, 1974]
On retrouve bien, dans ce t√©moignage fameux, les conditions d‚Äôune attention toute ¬´ embu√©e ¬ª par les vapeurs de l‚Äôinconscient (¬´ perdu dans mon r√™ve ¬ª). Pourtant il ne faut pas se tromper : il semble bien que l‚Äôexp√©rience perceptive faite par Kandinsky dans son atelier cr√©pusculaire soit, non la sortie de son r√™ve et de son travail cr√©ateur, mais leur aboutissement commun, √Ý savoir une plong√©e dans l‚Äôindiff√©renciation ¬´ int√©rieure ¬ª qui contribue, en relation avec les conditions de la r√©alit√© ext√©rieure, √Ý lui procurer un sentiment de ¬´ beaut√© indescriptible ¬ª. La rupture avec la fonction de reconnaissance est identique chez Ross m√™me si, chez ce dernier, elle provient de la s√©paration de l‚Äôobjet de son contexte d‚Äôusage et non d‚Äôun simple renversement des codes de la repr√©sentation : mais n‚Äôest-ce pas l√Ý une affaire de degr√© ? Dans les deux cas, on assiste √Ý une incertitude de la conscience superficielle face √Ý ce qui se pr√©sente de mani√®re ind√©termin√©e et produit sur elle un effet disruptif. On remarque d‚Äôailleurs que, comme le visiteur entrant dans la salle d‚Äôexposition de Michael Ross, Kandinsky ne peut accepter longtemps l‚Äô√©chec du regard dans ses fonctions discriminatives ni le trouble qui l‚Äôaccompagne, et il se ¬´ dirige rapidement ¬ª vers son tableau pour ¬´ trouver aussit√¥t le mot de l‚Äô√©nigme ¬ª. D√®s le lendemain, il est ¬´ fix√© ¬ª et, curieux paradoxe, il d√©cide volontairement d‚Äô√©carter ce qui lui avait √©chapp√© malgr√© lui. En somme, Kandinsky ne reconna√Æt pas √Ý ¬´ l‚Äôobjet ¬ª, confondu avec sa repr√©sentation, la capacit√© √Ý introduire une faille dans le sujet, qui demeure enti√®rement souverain dans le travail cr√©ateur.
(Texte publié avec l’aimable autorisation des éditions du Frac Bourgogne)
L’artiste
Michael Ross est n√© en 1955 √Ý Buffalo, New York, √âtats-Unis.

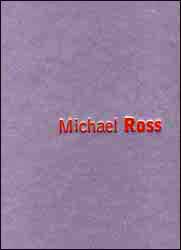

 parisART sur Instagram
parisART sur Instagram