Julie Aminthe. Depuis le milieu des annĂ©es 90, on assiste Ă un retour en force de la pensĂ©e marxiste. Comment expliquez-vous ce regain d’intĂ©rĂŞt – après des dĂ©cennies de mise Ă l’ombre – alors mĂŞme que semble s’imposer la fin des utopies?
Jean-Marc Lachaud. Au regard de ce qu’on a appelĂ© – notamment Jean-François Lyotard: «l’effondrement des grands rĂ©cits», on a pu considĂ©rer que la fin de l’histoire Ă©tait advenue. Jacques Rancière rejette ce point de vue Ă juste titre, et pointe du doigt toutes les finitudes, y compris celle de l’art.
En ce qui concerne la rĂ©surgence de la pensĂ©e marxiste, je pense qu’elle est tout simplement liĂ©e au fait que l’histoire continue. La violence du monde n’a jamais Ă©tĂ© aussi importante qu’aujourd’hui, Ă tous les niveaux (Ă©conomique, social, culturel et militaire). Le «principe espĂ©rance», comme disait Ernst Bloch, reste donc actif. Ce qui explique que l’on recherche – du cĂ´tĂ© de la contestation politique ou sociale, voire de la contestation artistique – de nouveaux modes de rĂ©sistance.
La pensĂ©e de Marx est lĂ , prĂ©sente, et chacun se la rĂ©approprie. Il ne s’agit Ă©videmment pas de rĂ©pĂ©ter les croyances, les illusions du XXe siècle. Il s’agit, Ă partir de cette pensĂ©e critique, de repenser une alternative Ă©ventuelle, un autre monde possible.
La pièce de l’historien et politologue amĂ©ricain Howard Zinn: Karl Marx, le retour (1995) est emblĂ©matique de cette rĂ©appropriation contemporaine de la pensĂ©e marxiste?
Jean-Marc Lachaud. Je pense que c’est un des Ă©lĂ©ments qui montre Ă quel point la pensĂ©e de Marx, Ă condition qu’on ne l’envisage pas d’un point de vue figĂ©, peut ĂŞtre utile aujourd’hui pour ceux qui n’abdiquent pas.
Le fait que cette pièce soit Ă nouveau reprĂ©sentĂ©e atteste que la figure de Marx, en tant que porteur d’une pensĂ©e critique, est toujours vivace.
Il n’existe pas d’esthĂ©tique marxiste Ă proprement parler. NĂ©anmoins, Marx et Engels ont consacrĂ© quelques pages Ă la crĂ©ation artistique. Quels sont les axes centraux dĂ©veloppĂ©s dans leur rĂ©flexion esthĂ©tique? Les points essentiels sur lesquels ils ne transigent jamais?
Jean-Marc Lachaud. Il n’y a effectivement pas de thĂ©orie marxiste de l’art. Ceci dit, comme vous le dites, Marx et Engels posent un certain nombre d’axes.
Le premier renvoie Ă l’utopie communiste dans le sens de l’avènement d’une sociĂ©tĂ© sans classes. Marx envisage une sociĂ©tĂ© oĂą chacun sera tour Ă tour poète, peintre etc. C’est la fin de la spĂ©cificitĂ© d’un travail qui est liĂ©e Ă l’histoire de la division du travail et de la lutte des classes.
Le deuxième axe, et il faut insister lĂ -dessus, c’est que jamais ni Marx ni Engels – y compris quand ce dernier parle de la littĂ©rature rĂ©aliste, n’ont donnĂ© de règles aux crĂ©ateurs. Il n’y a pas de modèle de littĂ©rature rĂ©aliste, et Engels insiste sur le fait que ce qui doit toujours ĂŞtre dĂ©terminant, c’est la valeur esthĂ©tique de la production, et non l’engagement politique de l’artiste. Balzac Ă©tait par exemple un Ă©crivain bourgeois, mais cela ne l’a pas empĂŞchĂ© d’ĂŞtre l’un des principaux critiques de la sociĂ©tĂ© de l’Ă©poque Ă travers ses œuvres.
Ce dĂ©bat va rĂ©sonner au XXe siècle, notamment autour du modèle sartrien de l’engagement – qu’il n’applique d’ailleurs Ă©trangement qu’au seul champ de la littĂ©rature, et qui sera assez radicalement remis en question par Theodor W. Adorno. D’après Sartre, un artiste engagĂ© est un artiste qui projette au travers de son œuvre sa sensibilitĂ© au monde. Or, pour Adorno, comme pour Marx et Engels avant lui, peu importe la pensĂ©e politique de l’artiste, ce qui importe c’est la manière dont une œuvre d’art – Ă travers sa mise en forme – affirme son irrĂ©ductible opposition Ă la rĂ©alitĂ© existante.
L’œuvre est donc en mesure de dĂ©passer l’individu qui l’a crĂ©Ă©e.
Jean-Marc Lachaud. Tout Ă fait. On peut toujours repĂ©rer ici ou lĂ un certain volontarisme qui concerne l’Ă©ducation des masses ou du moins sa prise de conscience – comme chez Bertolt Brecht. Mais, au-delĂ de l’intentionnalitĂ©, les spectateurs qui assistent Ă la reprĂ©sentation d’une pièce de Brecht, quels que soient le contexte et l’Ă©poque, s’approprient presque subjectivement la proposition du dramaturge. C’est qu’entre l’intention de l’artiste et la rĂ©ception de son œuvre, il y a forcĂ©ment un Ă©cart.
Le rĂ©alisme socialiste soviĂ©tique s’est appuyĂ© sur les textes de Marx et d’Engels pour asseoir sa lĂ©gitimitĂ©.
Or, en se mettant au service du Parti communiste, l’art a perdu son autonomie crĂ©ative pour ne devenir qu’un support de propagande supplĂ©mentaire et socialement utile. C’est le risque Ă payer lorsque l’engagement prend le pas sur la poĂ©sie?
Jean-Marc Lachaud. En se replongeant dans l’Ă©poque, on remarque que pendant quelques annĂ©es l’art et la littĂ©rature ont connu une grande libertĂ© de crĂ©ation en Union soviĂ©tique. Bien que LĂ©nine et un certain nombre de dirigeants rĂ©volutionnaires n’apprĂ©ciaient guère les recherches expĂ©rimentales, il y a eu une incontestable adĂ©quation entre la volontĂ© de construire un nouveau monde et celle de fonder un art qui rĂ©pondrait au dĂ©fi de cette perspective.
Mais avec le stalinisme, l’idĂ©ologie rĂ©aliste socialiste – qui n’est Ă dire vrai ni rĂ©aliste ni socialiste, s’est imposĂ©e. Les œuvres produites Ă©taient alors en contradiction absolue avec la rĂ©flexion esthĂ©tique entreprise par Marx et Engels. Loin de faire preuve d’indĂ©pendance par rapport Ă l’idĂ©ologie, elles se sont en effet soumises aux impĂ©ratifs du Parti, n’hĂ©sitant pas Ă distordre la vĂ©ritĂ© et Ă idĂ©aliser la rĂ©alitĂ© au nom de l’Ă©dification du stalinisme.
Brecht, pour le citer une nouvelle fois, notamment dans la querelle Ă propos de l’expressionisme, s’est opposĂ© Ă cette instrumentalisation de la pratique artistique. Au-delĂ des modèles du passĂ©, il dĂ©fendait une Ă©criture critique laissant advenir des « images-souhaits » (Ernst Bloch).
A quoi bon un art utilitaire au service d’un parti ou d’une idĂ©ologie politique? S’il s’agit de changer le monde, des travaux d’Ă©conomie, de sociologie, voire les mouvements sociopolitiques eux-mĂŞmes, sont bien plus efficaces. L’art n’a jamais changĂ© la rĂ©alitĂ© concrètement. Ce qui ne l’empĂŞche pas de receler un pouvoir remarquable: celui de nous impliquer, Ă travers les expĂ©riences qu’il conduit, dans un processus qui vise Ă la transformation du monde.
Presque paradoxalement, ce sont les œuvres qui ne se donnent pas comme finalitĂ© de diffuser un message politique qui recèlent un vĂ©ritable pouvoir Ă©mancipateur – aussi bien individuel que collectif, en lien avec l’espĂ©rance communiste. Dans votre ouvrage, vous faites notamment rĂ©fĂ©rence aux Ă©crits de Beckett et de Kafka.
Jean-Marc Lachaud. Ces œuvres nous proposent en effet une expĂ©rience de l’Ă©cart par rapport au monde administrĂ©. C’est prĂ©cisĂ©ment grâce Ă cela que l’art peut introduire en nous-mĂŞmes une sorte de perturbation susceptible de nous amener Ă nous dĂ©tacher de l’idĂ©ologie dominante et de sa rĂ©alitĂ© pesante. Le rĂ´le de l’imagination est alors dĂ©cisif. En optant pour le dĂ©calage, l’art nous invite Ă©galement Ă inventer d’autres paysages.
En mĂŞme temps, l’art militant a lui aussi Ă©tĂ© inventif au niveau de la forme. Ses crĂ©ations Ă©taient bien entendu traversĂ©es par un projet politique, mais elles faisaient Ă©galement l’Ă©loge d’un nouveau langage, d’un nouveau vocabulaire, d’une nouvelle façon d’ĂŞtre au monde. Je pense par exemple aux poèmes de Vladimir MaĂŻakovski ou au théâtre d’Armand Gatti.
Derrière l’Ă©tiquette «art militant», on trouve donc des œuvres qui sont des porte-voix des luttes et des aspirations de la sociĂ©tĂ©, et des œuvres qui troublent l’ordre du monde en offrant une expĂ©rience transgressive au lecteur ou au regardeur.
Plus largement, de Beckett Ă Gatti, les crĂ©ations qui crĂ©ent de l’Ă©change au niveau du sensible participent toutes Ă la dĂ©structuration de la domination.
Qu’est-ce qui rend une œuvre politique: sa forme esthĂ©tique ou son contenu idĂ©ologique? Il y a eu de nombreux dĂ©bats autour de cette question et, en vous lisant, on a le sentiment, bien que les deux facteurs ne soient pas inconciliables (théâtre d’agit propre), que c’est nĂ©anmoins la forme esthĂ©tique qui prime.
Jean-Marc Lachaud. Absolument. Il y a toute une tradition dans le marxisme non orthodoxe – allant de Walter Benjamin Ă Herbert Marcuse – qui affirme que c’est par le moment de la forme que la critique de l’art s’impose et participe singulièrement Ă une Ă©ventuelle volontĂ© de changer la vie et de transformer le monde.
Pour autant, il ne faut pas opposer la forme et le contenu. Je pense que les œuvres les plus pertinentes, au sens critique du terme, sont celles qui parviennent Ă une espèce d’Ă©quilibre entre les deux. Au travers de la forme, un sens doit se dĂ©cliner et permettre aux destinataires d’Ă©chapper aux conventions et de vivre un moment subversif.
En fin de compte, les œuvres vĂ©ritablement engagĂ©es ne se contentent pas de rĂ©vĂ©ler la rĂ©alitĂ© du rĂ©el,
ses contradictions comme ses complexitĂ©s, comme le faisaient les auteurs rĂ©alistes du 19ème siècle. Elles ne se contentent pas non plus de reprĂ©senter la rĂ©alitĂ© dans son dĂ©veloppement rĂ©volutionnaire, comme le faisaient les rĂ©alistes socialistes soviĂ©tiques du temps de Staline. Les œuvres vĂ©ritablement engagĂ©es rendent visibles les mĂ©canismes sociĂ©tales qui gouvernent – en tapinois – notre façon de penser et de vivre, tout en esquissant d’autres mondes possibles. Dit autrement, elles contestent radicalement l’ordre Ă©tabli (force nĂ©gative) et proposent simultanĂ©ment des alternatives (force positive). Deux Ă©lĂ©ments semblent donc indispensables: une fine et juste connaissance du monde dans lequel nous vivons et une grande facultĂ© d’imagination, empreinte de rĂŞves et d’espĂ©rances; un «pessimisme de l’intelligence» et un «optimisme de la volonté» comme dirait Gramsci.
Jean-Marc Lachaud. C’est un bon rĂ©sumĂ©. Parce que ce sont des appels aux rĂŞves et, quelque part, Ă l’insurrection ou Ă l’Ă©meute, que les œuvres engagĂ©es peuvent ĂŞtre pensĂ©es comme telles. C’est dans cet effet de projection vers autre chose qu’elles se particularisent. MĂŞme si l’horizon qu’elles pointent reste indĂ©terminĂ© – les modèles artistiques Ă©tant souvent incertains et alĂ©atoires. Le double mouvement, Ă la fois contestataire et ouvert sur les «possibles impossibles» (Henri Lefebvre), est donc essentiel.
Walter Benjamin, qui dĂ©veloppe une philosophie de l’histoire assez pessimiste, en annonçant notamment la Catastrophe qui s’est avĂ©rĂ©e (Holocauste), maintient au mĂŞme moment l’idĂ©e que rien n’est dĂ©finitivement achevĂ©, et que d’autres champs d’action peuvent ĂŞtre malgrĂ© tout envisagĂ©s.
Dernier point d’importance: la situation des artistes est toujours liĂ©e Ă l’Ă©poque au sein de laquelle ils crĂ©ent. Dans les annĂ©es 20, et plus tardivement dans les annĂ©es 60-70, il y avait une sorte d’Ă©cho entre les luttes auxquelles la population participait et les mouvements artistiques. Ces derniers se forgeaient alors en complicitĂ© avec les aspirations dĂ©fendues.
Dans les pĂ©riodes plus «moroses», le rĂ´le des artistes est Ă©videmment plus difficile Ă circonscrire. Avec le dĂ©veloppement des industries culturelles, l’art tend peut-ĂŞtre Ă se dissoudre dans ce grand tout culturel. Comme le dit très bien Dominique BaquĂ© dans son ouvrage: Pour un nouvel art politique, certains artistes se sentent aujourd’hui attirĂ©s par les logiques dominantes de la sociĂ©tĂ©. MalgrĂ© tout, il y a un certain nombre de propositions artistiques qui maintiennent – sans illusions naĂŻves – un certain questionnement sur le rapport Ă l’histoire, tout en envisageant la possibilitĂ© de construire un monde diffĂ©rent. Je pense aux crĂ©ations du plasticien Ernest Pignon-Ernest par exemple.
A l’heure actuelle, l’idĂ©e qu’il n’y a pas d’alternative au monde dans lequel nous vivons semble s’ĂŞtre ancrĂ©e dans les cerveaux. Les artistes, comme le reste de la population, n’Ă©chappent pas Ă l’argumentaire servi par le système dominant. Beaucoup d’œuvres recèlent alors une puissance critique, sans nĂ©anmoins parvenir Ă esquisser un autre paysage…
Jean-Marc Lachaud. On ne peut pas demander aux artistes d’ĂŞtre plus visionnaires que les autres membres de la sociĂ©tĂ©. HantĂ©s par l’hĂ©ritage du XXe siècle – ses tragĂ©dies comme ses impasses, nous sommes tous en panne par rapport Ă un quelconque modèle alternatif. Il est donc «normal» que les crĂ©ateurs, hĂ©sitants, se retrouvent devant l’impossibilitĂ© de produire les images prĂ©dĂ©terminĂ©es d’un avenir plus ou moins proche. Leur force est donc d’ĂŞtre dans la rĂ©sistance active, dans ce que Daniel BensaĂŻd appelait «le pari mĂ©lancolique».
Du cĂ´tĂ© du théâtre, de Sarah Kane Ă Rodrigo Garcia, est revendiquĂ©e une sorte de refus de la rĂ©alitĂ© prĂ©sente, mais sans proposer – c’est vrai, une alternative concrète. Peut-ĂŞtre heureusement d’ailleurs. Les artistes ouvrent des perspectives. C’est Ă nous de dĂ©fricher ces chemins et d’inventer un Ă©ventuel autre monde. On ne peut pas exiger des crĂ©ateurs ce que nous-mĂŞmes, Ă notre niveau, ne sommes pas capables de formuler.
Les forces dominantes ont donc réussi à paralyser, ou du moins à modeler, les imaginaires de chacun, artistes comme non artistes.
Jean-Marc Lachaud. Sans doute. Et, en mĂŞme temps, en suivant la perspective d’un Fredric Jameson, y compris dans les productions de la culture industrielle, on peut sĂ»rement dĂ©couvrir des ferments de rĂ©sistance. Il faut seulement savoir trouver ce qui effectue un pas de cĂ´tĂ© par rapport Ă la logique dominante. Et peut-ĂŞtre admettre aussi que certaines sĂ©ries tĂ©lĂ©visĂ©es, par exemple, font davantage pour la prise de conscience et la dĂ©marche vers l’Ă©mancipation que des formes plus nobles.
Dans L’Homme unidimensionnel, Herbert Marcuse dĂ©crit très bien comment la machine capitaliste se sert des contradicteurs pour asseoir sa lĂ©gitimitĂ© et se donner des airs de tolĂ©rance.
Jean-Marc Lachaud. Sa logique Ă©tant essentiellement Ă©conomique, Ă partir du moment oĂą il y a un marchĂ© pour des productions «contestataires», elle ne s’en prive pas. Pourquoi le ferait-t-elle?
Quant à sa permissivité, elle existe mais doit être relativisée. Un certain nombre de retours à la censure, plus ou moins déguisés, apparaît en effet ici et là .
Enfin, qu’il soit possible de dĂ©velopper au cœur mĂŞme du système des contradictions ne leur Ă´te pas pour autant leur puissance critique. C’est une brèche au sein de la machine que les artistes doivent emprunter pour faire bouger notre rapport au monde et aux autres.
Jean-Charles Massera, dont le metteur en scène Benoit Lambert a utilisĂ© les textes pour crĂ©er ses derniers spectacles (We are la France, We are l’Europe, Que faire?), dĂ©clare faire de l’entrisme. C’est-Ă -dire qu’il pĂ©nètre Ă l’intĂ©rieur du système pour dĂ©noncer ses codes et mettre en lumière ses absurditĂ©s.
Jean-Marc Lachaud. Cette stratégie de ruse a souvent été utilisée par les artistes et les écrivains. Benoit Lambert fait partie de ces metteurs en scène qui nous proposent de déjouer le système en faisant exploser ses lignes.
MĂŞme Ă l’heure du capitalisme qui transforme tout ce qu’il touche en marchandises Ă consommer, l’œuvre d’art parvient encore Ă Ă©chapper Ă l’emprise de la rĂ©alitĂ© immĂ©diate. Mais cette rĂ©ussite est pour le moins mystĂ©rieuse – du moins pour l’intellect qui reste coi. Cela s’apparente presque Ă de la magie…
Jean-Marc Lachaud. L’œuvre d’art ne naĂ®t pas de rien. Elle n’est pas en apesanteur au-delĂ de la rĂ©alitĂ©, au contraire, elle s’en nourrit. On Ă©voquait le moment de la forme tout Ă l’heure. C’est sans doute Ă ce stade dĂ©cisif que la rĂ©alitĂ© qui l’abreuve devient autre, et peut prendre des configurations inimaginables, intempestives. Je ne sais pas si c’est de l’ordre de la magie… Je crois que c’est simplement dans le processus mĂŞme de la fabrication de l’œuvre que se joue ce basculement. Les Ă©lĂ©ments de la rĂ©alitĂ© empirique façonnent alors de nouvelles visions.
Peut-ĂŞtre doit-on entendre la crĂ©ation artistique comme une sorte de flânerie au sein des ruines? Soit les ruines sont dĂ©finitivement figĂ©es et nous renvoient toujours nostalgiquement Ă ce qui a Ă©tĂ©. Soit les ruines sont considĂ©rĂ©es comme les simples pièces d’un jeu de construction sans modèle prĂ©Ă©tabli. A partir ce ces restes brisĂ©s de la rĂ©alitĂ©, on peut alors s’imaginer un nouveau monde possible.
Toute crĂ©ation est donc l’enfant de son temps. Et, en mĂŞme temps, chaque œuvre est aussi en mesure d’interpeller d’autres Ă©poques.
Jean-Marc Lachaud. C’est ce qui fait peut-ĂŞtre la particularitĂ© de l’art. Marx parle maladroitement du «charme Ă©ternel» en Ă©voquant l’art grec. Je n’utiliserais pas cette formule, car cela impliquerait que l’art soit dans une sorte d’effet de transcendance au-delĂ des temps. Je dirais seulement qu’il y a des promesses de libertĂ© contenues dans les œuvres d’art du passĂ©. N’Ă©tant pas encore concrĂ©tisĂ©es, elles continuent de nous interpeller, mĂŞme si plusieurs siècles nous sĂ©parent.
Si la sociĂ©tĂ© rĂŞvĂ©e – sans classes ni oppression – advenait, ce serait la mort de l’art, par essence contestataire et utopique?
Jean-Marc Lachaud. Toute l’histoire de l’art et de la littĂ©rature nous montre que beaucoup de productions sont pleinement en accord avec le monde tel qu’il est. On ne peut donc pas dire que les œuvres d’art contiennent toutes un aspect critique et utopique.
De plus, mĂŞme si l’utopie de Marx se rĂ©alisait – l’avènement d’une sociĂ©tĂ© sans classes, toutes les contradictions ne seraient pas totalement rĂ©solues. Il n’y aura donc jamais de finitude de l’art, mĂŞme engagĂ©, et heureusement. Sinon le meilleur des mondes serait terrifiant.
C’est lorsque l’Histoire est la plus trouble que les hommes produisent un art Ă©minemment «intĂ©ressant»?
Jean-Marc Lachaud. Au regard du XXe siècle, qui est un terrain que je connais bien, sans conteste oui. C’est dans les moments les plus tourmentĂ©s, voire les plus tragiques, que l’art expose sa plus grande libertĂ© en exerçant sa capacitĂ© novatrice, non pas pour conjurer les Ă©vènements, mais pour rĂ©pondre au dĂ©fi de l’Histoire en marche. Ces pĂ©riodes de troubles impliquent donc une exigence artistique exacerbĂ©e, et une relation s’Ă©tablit alors entre ce qui s’exprime au sein des sociĂ©tĂ©s et ce qui s’exprime dans les champs artistiques.
Après la Shoah, les artistes ont rencontré de vraies difficultés créatrices: que peut-on proposer artistiquement après un tel désastre, se demandaient-ils?
Jean-Marc Lachaud. Jusqu’Ă ce retour de la barbarie au cœur des sociĂ©tĂ©s occidentales, on valorisait la puissance de la culture. C’est une sorte de dĂ©menti, d’Ă©chec cinglant, très finement analysĂ© par Theodor W. Adorno qui Ă©voque l’aveuglement face Ă cette logique des lumières, du progrès etc. Après la Catastrophe, le moment de fracture Ă©tait donc inĂ©vitable. Mais, dans la deuxième partie du XXe siècle, tout en prenant en compte cette irruption de la barbarie, et sans plus trop croire au progrès, les artistes ont su retrouver, peut-ĂŞtre avec plus de modestie et de rĂ©serve qu’auparavant, cette force de penser d’autres rĂ©alitĂ©s, malgrĂ© tout.
Au sein du milieu théâtral, les auteurs sont à présent un peu boudés par les metteurs en scène et les troupes de comédiens, et ce sont les historiens, les politologues, les économistes qui ont leur faveur. Quel est votre regard à ce sujet?
Jean-Marc Lachaud. Fidèles aux expĂ©rimentations de la modernitĂ© artistique et littĂ©raire, on ne peut pas s’Ă©tonner que des textes politiques, sociologiques puissent ĂŞtre utilisĂ©s par des metteurs en scène. DĂ©sormais, tous les matĂ©riaux sont possibles pour l’art, pourquoi pas cela? Tout dĂ©pend au fond de comment on se les approprie. S’il s’agit simplement d’effectuer une sorte de lecture d’un texte Ă©conomique ou sociologique, on n’a peut-ĂŞtre pas besoin du théâtre pour le faire. Ce qui compte, c’est la manière dont on utilise ces matĂ©riaux pour rendre compte d’une vision qui dĂ©passe les auteurs des Ă©crits en question.
Aujourd’hui, on semble demander au théâtre, et peut-ĂŞtre Ă l’art en gĂ©nĂ©ral, d’expliquer – en prioritĂ© et le plus frontalement possible – les tenants et les aboutissants du système nĂ©ocapitaliste, trop abscons pour la plupart d’entre nous.
Jean-Marc Lachaud. La pĂ©dagogie, au mauvais sens du terme, peut ĂŞtre très ennuyeuse. Mais la pĂ©dagogie active, qui expose un certain nombre de propos sur le fonctionnement du monde sans occuper une position de supĂ©rioritĂ©, ouvre le dialogue entre artistes et public. Ce type de propositions, si elles sont bien faites au niveau de la forme, peut favoriser cet espace de l’Ă©change; un espace essentiel Ă l’heure oĂą les discours dominants obstruent la pensĂ©e.
De ce point de vue, la pièce crĂ©Ă©e par le collectif d’artistes Groupov: Rwanda 94, est emblĂ©matique. Elle ne lâche rien au niveau du sens tout en Ă©chappant Ă un pĂ©dagogisme simpliste. En s’inspirant, entre autres, de l’hĂ©ritage brechtien, Rwanda 94 rĂ©ussit Ă susciter autre chose que de la pitiĂ© ou de l’identification. Aucune vision morale n’est dĂ©fendue. Ce qui prime, ce sont les interrogations soulevĂ©es et les rĂ©actions provoquĂ©es.
Depuis quelques annĂ©es, on assiste Ă©galement Ă l’Ă©mergence du corps sur la scène.
Jean-Marc Lachaud. C’est frappant oui. Et je crois d’ailleurs que c’est Ă travers le corps que passent les capacitĂ©s de rĂ©sistance et d’invention. Le retour de la performance est assez significatif de ce point de vue-lĂ . Mais quel corps nous montre-t-on au juste? L’engouement par rapport au corps de la victime peut ĂŞtre problĂ©matique, car l’on tend alors vers un art de la compassion. D’autres propositions, en interrogeant la situation faite au corps, peut aller au-delĂ de la simple exhibition afin de critiquer l’Ă©tat du monde.
La question de l’adresse vous semble-t-elle une question essentielle? Dit autrement, l’artiste doit-il prendre en compte – en crĂ©ant – le public qui expĂ©rimentera ses œuvres, c’est-Ă -dire un public de classe moyenne et plus, aux idĂ©es plutĂ´t Ă gauche?
Jean-Marc Lachaud. MalgrĂ© le processus de dĂ©mocratisation de l’accès Ă l’art et Ă la culture, le public, bien qu’il n’appartienne plus uniquement Ă la grande bourgeoisie, est encore un public restreint. L’artiste peut toujours essayer de s’adresser Ă ce qu’on appelait dans les annĂ©es 70 « le non-public », en dĂ©sertant les murs et les lieux artistiques, mais cette pratique a ses limites. Pour preuve, les arts de la rue sont finalement suivis par le mĂŞme public que celui que l’on croise dans les institutions culturelles.
Une fois encore, on ne peut pas faire reproche aux artistes d’agir dans le cadre contraignant qui est celui que l’on rĂ©serve Ă la culture et Ă l’art aujourd’hui. Il y a des tentatives, du cĂ´tĂ© des arts plastiques par exemple. Certains crĂ©ateurs disposent leurs œuvres d’art dans des musĂ©es Ă©phĂ©mères, en banlieue, afin de crĂ©er une possible rencontre avec un public non averti. Mais ce genre d’initiatives ne rĂ©sout pas le problème de l’accès Ă la culture, qui est un problème avant tout politique.
A mon avis, les œuvres ne doivent pas conforter le consensus qui lie l’ĂŞtre-ensemble d’une sorte de «communauté» de spectateurs. L’art doit, au contraire, parmi les bonnes consciences de gauche, mettre en doute et Ă©viter toute forme de complaisance.
Aujourd’hui, les œuvres hybrides, mĂ©tissĂ©es, qui ne sont pas immĂ©diatement identifiables, font bouger les lignes et favorisent le dĂ©ploiement de questionnements nouveaux (comme notre rapport Ă la science, Ă travers le phĂ©nomène de clonage et l’idĂ©e de post-humanitĂ©). Des questionnements qui ne paraissent pas politiques et qui pourtant le sont, suscitant ainsi de nouvelles formes capables de les apprĂ©hender – tout en vĂ©hiculant une force de joie que l’ordre Ă©tabli a trop souvent tendance Ă brider.
— Lire l’ouvrage de Jean-Marc Lachaud: Art et aliĂ©nation, Ă©ditions PUF, paris, 2012.

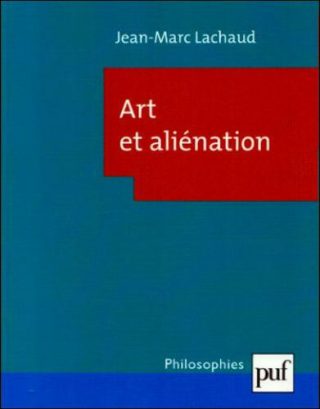

 parisART sur Instagram
parisART sur Instagram