— Auteurs : André Martin, entretien avec Jérôme Sans
— Éditeur : Centre culturel du Canada, Paris
— Collection : Esplanade
— Année : 1998
— Format : 15 x 12 cm
— Illustrations : nombreuses, en couleurs et en noir et blanc
— Pages : 113
— Langues : français, anglais
— ISBN : 1-896940-09-9
— Prix : non précisé
Le photographe dans l’ombre de la photographie
par Catherine Bédard
Chroniques et autres révélations réunit deux des plus importants projets réalisés par André Martin entre 1990 et 1997 : Le Parfum de la dame en noir et Chroniques de L’express.
Ces deux volets de l’exposition montrent comment l’artiste, qui est aussi écrivain, part du principe de l’enquête — de la surveillance, de l’écoute illicite, de l’indiscrétion — pour mettre en images des révélations. La révélation, dans la pratique d’André Martin, unit indissociablement le mot à l’image pour jouer à la fois sur le registre de l’intimité dévoilée et sur celui, proprement photographique, de l’apparition.
Chroniques de L’Express, est le résultat d’une année entière de dîners solitaires pris dans un célèbre restaurant de Montréal (L’Express, le restaurant des célébrités locales, de ceux désireux de les côtoyer et des autres, attirés par la plus parfaite incarnation du bistrot français). Sur la nappe de papier où s’associent plaisirs du repas et plaisirs du risque, l’artiste-enquêteur a pris des notes de ce qu’il entendait se raconter autour de lui, notes qui font s’entrecroiser les sphères privée, intime et publique.
Les nappes transformées en tables d’écoute sont aussi le recueil des pensées affolées, des doutes et des enthousiasmes de l’artiste qui se livre là dans son rôle embarrassant d’épieur épié (mais que livre-t-il au juste, lui qui fait œuvre de fiction, lui qui sait nous faire croire à la confidence autant que s’en méfier ?), et qui se livre du même coup à un jeu de cache-cache avec le monde qui l’entoure, monde de représentation dont le tableau final (l’exposition) ne conservera aucune figure de vanité. C’est la représentation de l’enquête en effet que l’artiste a choisi de montrer, aussi ne verra-t-on aucun des personnages observés à l’exception du corps tronqué d’un des serveurs, le personnage sans doute le plus important de l’entreprise, celui dont on ne sait à quel point il est complice mais qui orchestre néanmoins l’ensemble des soirées. Sa présence, la seule à avoir retenu le regard du photographe, laisse supposer que l’enquête était destinée à dériver sur les fantasmes de l’enquêteur comme en témoigne la légende gravée, tirée du livre Chroniques de L’Express, qui accompagne cette image.
Celle-ci porte la trace d’un regard éminemment subjectif dont témoigne aussi le tableau monumental des notes manuscrites. Mais, comme si l’auteur doutait lui-même de la profondeur de toutes les impressions (pour ne pas dire sentiments) pouvant naître du monde de la représentation, le photographe (son double) préfère réduire toute image à un manifeste reflet. Le cliché du serveur est accompagné de son double inversé, de sorte que le personnage semble être pris en train de toucher sa propre image en miroir, et que le spectateur est face à un monde se présentant comme hermétiquement clos. Ainsi, la partie droite de l’image serait comme l’empreinte de celle de gauche (ou vice-versa), chaque diptyque se présentant alors comme l’image d’un livre ouvert où l’on verrait une page ayant déteint sur l’autre. (…)
Le Parfum de la dame en noir, qui doit son titre au roman de Gaston Leroux, est une série de photographies représentant une vertu ou un état psychologique. André Martin a obtenu ces images étonnantes en utilisant les propriétés lumineuses du phosphore. Chacune des figures constitue un portrait lumineux de l’absence et de la disparition : un personnage est modestement drapé, badigeonné de phosphore et prend la pose de la Pénitence, de la Douleur, de la Volonté, de la Bienvenue ou d’autres états et allégories; ce personnage reçoit un éclairage bref et intense qui stimule le phosphore puis, dans l’obscurité seulement éclairée par la phosphorescence, le personnage modifie sa pose dont tout le mouvement aura été enregistré par le photographe. Cette opération de prise de vue gomme tous les signes distinctifs de l’individu. Toutes ces figures, qui tentent d’approcher au plus près des états intimes mais parfaitement codés d’un personnage énigmatique, cherchent à exprimer, en se fondant sur l’acte photographique, la vérité fictive du personnage mystérieusement appelé la Dame en noir. La photographie ne prétend pas toucher ici à l’âme d’un individu. Elle laisse le soin à la matière chimique de révéler l’intimité d’un personnage en saisissant non pas ses traits mais sa silhouette fragile et obscure, violentée par la lumière.
Devant cette œuvre, on pourra dire encore comme le disait Barthes, et autrement, « la photographie a été, est encore tourmentée par le fantôme de la peinture »; mais, séduisant paradoxe, cette œuvre où l’effet pictural n’est qu’une apparition sans aucune substance est toute entière fondée sur l’exercice de la spécificité d’un phénomène optique destiné à rendre visible une ombre tout en la laissant dans l’obscurité. Au Parfum de la dame en noir, le photographe répond par des révélations énigmatiques qui mettent en scène une chambre noire — puisque les ombres se dressent devant un rideau de scène embrasé qui n’est autre qu’une figure de la pellicule sensible qu’on brûle en l’exposant à la lumière.
Voilà donc encore une histoire se déroulant en lieu clos : pour André Martin, le champ de l’image n’implique aucun hors-champ. C’est sans doute pourquoi il a tenu à faire voir, sous forme de « murale » photographique, le plan de L’Express, la seule image objective possible du lieu de ses chroniques. Il a également conçu un accompagnement contextuel au Parfum de la dame en noir en réalisant le plan au sol du lieu du crime tel que l’a publié Leroux lui-même — une maquette qui tient à la fois de l’arène et du labyrinthe —, le lieu (imaginaire) où tout a commencé. Ce plan est plutôt aveuglant que révélateur et, en tant que tel, il donne un indice de taille pour comprendre les obscures révélations photographiques de l’artiste. Ce que la photographie rend visible, c’est une illumination. Elle ne fait la lumière sur aucune énigme, elle ne cherche pas davantage à nous cacher quelque chose. Elle rend visible l’obscurité dont elle fait, par la magie du phosphore, un phénomène lumineux. Mais, étrangement, cette luminosité n’a pas de vertu éclairante : si des figures sont visibles en partie, comme autant d’indices d’une présence devenue fantomatique, elles semblent avoir la même immatérialité que leur ombre. D’ailleurs, de même que le noir renvoie presque à l’opacité d’une matière picturale, de même l’ombre portée de chaque silhouette a toutes les apparences d’un « repentir », comme on le dit joliment de ces indices plus ou moins dissimulés qui gardent la trace d’une forme que l’artiste n’a pas voulu retenir.
(Texte publié avec l’aimable autorisation du Centre culturel du Canada)

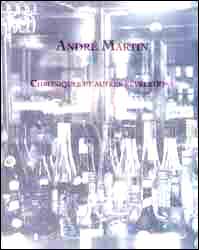

 parisART sur Instagram
parisART sur Instagram