De LâAutriche oÃđ elle est nÃĐe, à Berlin oÃđ elle vit aujourdâhui, en passant par Mayence, Glasgow, Copenhague ou Omaha, la vie de Barbara Breitenfellner aura ÃĐtÃĐ jusquâà aujourdâhui celle dâune nomade du nord.
Elle conserve de cette stratÃĐgie du dÃĐplacement un des principes essentiels du vagabond: voyager lÃĐger. Câest sans doute cette logique de lâallÃĻgement qui lâaura poussÃĐe, non pas à sâalourdir dâun style personnel, mais plutÃīt à interroger ce quâelle retrouve à chacun de ses atterrissages: le site de lâexposition.
Quâest-ce que cela signifie que dâexposer ses crÃĐations? Les Åuvres ainsi promenÃĐes dans le monde doivent-elles nÃĐcessairement affirmer une signification, un style, une dÃĐmarche repÃĐrable, toujours fidÃĻle à elle-mÊme? Quâest ce qui fait la diffÃĐrence entre une exposition dâÅuvres dâarts et un cabinet de curiositÃĐs qui rassemble des objets hÃĐtÃĐroclites, qui ont pour seul lien dâavoir ÃĐtÃĐ sÃĐlectionnÃĐs par la mÊme individualitÃĐ?
Autant de questions qui servent de fil rouge aux propositions de Barbara Breitenfellner, depuis ses installations pour ÂŦWe Should Have Occupied Every PlaceÂŧ (Saint-Etienne, 2005), ÂŦOpinions informesÂŧ (BÃĐtonsalon, Paris, 2006), ou ce mois-ci à la galerie Zurcher.
Sâen suit un travail qui soigne sa prÃĐsentation, usant du prÃĐsentoir, de la vitrine ou du sous verre. Mais surtout une proposition qui met littÃĐralement en abyme la logique de lâexposition, en disposant sur des tables noires des ÂŦÅuvresÂŧ qui sont elles-mÊmes des expositions, dans le sens ou elles mettent en places un jeu de superposition et de feuilletage qui dissimule autant quâil montre.
Car, tout bien rÃĐflÃĐchi, quâest-ce quâune exposition si ce nâest un convivial jeu de cache-cache, que se propose lâartiste et le visiteur: lâun se prÃĐsente, lâautre dÃĐcode, puis le premier sâÃĐchappe, pour que le second puisse mieux projeter sa propre intimitÃĐ dans une interprÃĐtation toute personnelle de lâÅuvre. Alors à quoi bon proposer des Åuvres, autant insister sur cette dynamique contradictoire du montrer-cacher.
Câest sans doute dans cet esprit quâil faut interprÃĐter ces petits modules qui sâamusent du feuilletage, de la superposition, du mÃĐdaillon qui fonctionne comme le trou de la serrure à travers lequel nous observons toujours ce qui nous intrigue.
Tout un jeu du dessus-dessous, dâexhibition-dissimulation, qui conjugue des photographies noires et blanches dâune utopie de bonheur, reprÃĐsentant des individus heureux et nus en communion avec le soleil et la nature, et des dessins, repris de livres de sciences naturelles, de tÊtes de serpents, serres dâoiseaux, chiens hurlant ou chauffe souris. Quelques choses de la poÃĐsie offensive et noire dâun LautrÃĐamont ou dâun Max Ernst apparente cette esthÃĐtique à un certain surrÃĐalisme. Un peu plus loin sur le mur, un cadre-boÃŪte fait office dâÅuvre manifeste: un singe en plomb (qui nâest pas sans faire penser à lâautoportrait en singe de Chardin) se tient derriÃĻre une vitre maquillÃĐe en grille à oculus, comme pris au piÃĻge par le jeu de lâexposition. Lâexposition, ou la mise au zoo de lâartiste? Pour Barbara Breitenfellner, il nây a certainement quâun pas.
Avec ElÃĐonore de Montesquiou, lâidentitÃĐ de lâartiste ne se veut plus fuyante, mais plutÃīt dÃĐcalÃĐe, comme dÃĐlÃĐguÃĐe, diluÃĐe dans son sujet. Sujet tendu entre secret et dÃĐmonstration, puisquâil sâagit de trois films, un jeu dâaffiches, et deux livres, qui traitent de sa rencontre avec deux villes fantÃīme de lâex Union SoviÃĐtique: SillamaÃĐ et Paldiski, les ÂŦAtom CitiesÂŧ.
En effet, de 1944 à 1991, SillamaÃĐ et Paldiski furent des villes closes et secrÃĻtes amÃĐnagÃĐes à des fins de recherches nuclÃĐaires. EffacÃĐes des cartes soviÃĐtiques, elles ÃĐtaient habitÃĐes par des russes et fermÃĐes aux Estoniens. Depuis lâindÃĐpendance de lâEstonie en 1991, les usines secrÃĻtes ont fermÃĐ, et la raison dâÊtre de la ville sâest ÃĐvaporÃĐe. Câest avec ces changements dâorientations que la question de lâidentitÃĐ des habitants sâest posÃĐes sur un mode singulier: alors que les russes vivaient là depuis plusieurs gÃĐnÃĐrations comme sur une ÃŪle oubliÃĐe du monde, ils sont aujourdâhui minoritaires et marginalisÃĐs sur un territoire quâils ÃĐprouvent comme celui de leurs ancÊtres et de leurs origines. Or, on ne peut pas avoir pour origine un secret dâÃĐtat.
Aujourdâhui, quand les russes de SillamaÃĐ interrogent leur hÃĐritage, ils se trouvent face à un trou noir de lâhistoire, une absence de rÃĐcit fondateur, un enfouissement de leurs sources. Câest ce que nous montrent les trois films prÃĐsentÃĐs par ElÃĐonore de Montesquiou.
Le premier est un portrait de ville, qui nous mÃĻne dâimages dâarchives de SillamaÃĐ, Ã des sÃĐquences contemporaines, filmÃĐes avec distance et discrÃĐtion dans les rues de la ville.
Le second, prÃĐsentant les commÃĐmorations qui cÃĐlÃĐbraient le 60e anniversaire de la victoire de lâarmÃĐe soviÃĐtique sur les troupes allemandes en 1945, rÃĐvÃĻle une ambivalence au sein de la population locale: alors que, pour certains, cette date sâapparente au triomphe dâune armÃĐe hÃĐroÃŊque, pour dâautres, elle renvoie à la triste mÃĐmoire de lâoccupation de lâEstonie par le pouvoir soviÃĐtique.
Le troisiÃĻme film apparaÃŪt comme le point final dâun parcours, puisquâil correspond au tÃĐmoignage individuel dâune jeune russe vivant difficilement cet effacement des origines, ÃĐprouvant cette rupture jusque dans sa vie familiale. Si bien que du portrait de la ville au portrait de la jeune fille, en passant par les ambiguÃŊtÃĐs dissimulÃĐes sous lâexaltations des combats hÃĐroÃŊques, câest tout un parcours initiatique que nous accomplissons. De lâhistoire collective jusquâà lâhistoire singuliÃĻre, la question du secret, de la parole refoulÃĐe, du dÃĐnie dâexistence et de rÃĐalitÃĐ donne toute sa dimension à ce triptyque en forme de quÊte identitaire.
Lâensemble se pare dâune teinte particuliÃĻre quand, au dÃĐtour dâun gÃĐnÃĐrique, on dÃĐcouvre que ElÃĐonore de Montesquiou est elle-mÊme partiellement estonienne. A travers les Åuvres de Barbara Breintenfellner à ElÃĐonore de Montesquiou, ce sont toutes les gÃĐnÃĐrations dâapatrides dâhier et dâaujourdâhui qui cherchent à retisser pour elles-mÊmes la trame dâun territoire dâorigine. Car on ne saurait transmettre sans avoir soi-mÊme reçu.
English translation: Laura Hunt


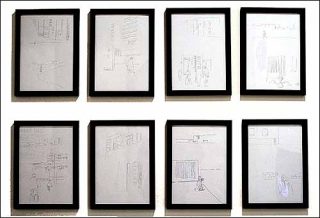




 parisART sur Instagram
parisART sur Instagram