┬½LŌĆÖart contemporain est nul┬╗.┬Ā La lecture de cette nouvelle contribution nŌĆÖa pas permis dŌĆÖapaiser ces craintes, bien au contraire.
Certes les motifs de critiquer lŌĆÖart contemporain ne manquent pas, comme on lŌĆÖa vu encore derni├©rement ├Ā lŌĆÖoccasion de la sp├®culation ├Ā grand spectacle dont il a ├®t├® la cible. Mais lŌĆÖart contemporain nŌĆÖest jamais r├®ductible ├Ā une g├®n├®ralit├®, car il se compose dŌĆÖune multiplicit├® contrast├®e de pratiques et de mat├®riaux, de productions et dŌĆÖ┼ōuvres, de lieux tr├©s divers, ainsi que dŌĆÖartistes aux talents in├®gaux et aux situations sociales et ├®conomiques vari├®es.
En fait lŌĆÖarticle fustige moins lŌĆÖart contemporain proprement dit quŌĆÖune pratique mus├®ale qualifi├®e dŌĆÖ┬½art contemporain obligatoire┬╗ qui consiste en quelque sorte ├Ā contaminer les lieux dŌĆÖart ancien ŌĆö Le Louvre, Orsay, les mus├®es Bourdelle, Rodin ou encore de la Chasse ŌĆö par des expositions dŌĆÖartistes contemporains, en quelque sorte impos├®es aux visiteurs contre leur gr├®. Le ph├®nom├©ne est ├®vident et en plein essor, mais le constat et la condamnation ne valent pas analyse, qui fait cruellement d├®faut.
┬Ā
Cette contamination des mus├®es et lieux patrimoniaux sŌĆÖinscrit dans un mouvement g├®n├®ral de d├®sp├®cialisation des espaces, des pratiques et m├¬mes des genres artistiques et culturels. D├©s lors que les artistes passent dŌĆÖune pratique ├Ā une autre, combinent les mat├®riaux, et se pensent (globalement) artistes plut├┤t que (sp├®cifiquement) peintres, sculpteurs ou photographes, les lieux ont, eux aussi, tendance ├Ā ├¬tre emport├®s dans une comparable perm├®abilit├®.
Du Land Art aux friches postindustrielles, lŌĆÖart contemporain nŌĆÖa cess├® de migrer de lieux en lieux jusquŌĆÖ├Ā trouver, dans la derni├©re p├®riode, ├®pisodiquement refuge dans les mus├®es ├Ā la fois les plus prestigieux et les plus ├®loign├®s de lui.
Ce nomadisme de lŌĆÖart contemporain, qui invente ses lieux en m├¬me temps que ses formes et ses publics, qui est dŌĆÖune certaine fa├¦on perp├®tuellement contraint de circonscrire son territoire au sein du champ ├®tabli de la culture, est peut-├¬tre un trait de sa contemporan├®it├®.
Mais le fait que ce nomadisme conduit aujourdŌĆÖhui lŌĆÖart contemporain ├Ā croiser lŌĆÖart ancien dans ses bastions les plus prestigieux est favoris├® par la situation qui pr├®vaut sur la sc├©ne internationale de lŌĆÖart: la concurrence f├®roce que se livrent les grands mus├®es, et la sp├®culation financi├©re en mati├©re dŌĆÖart.
LŌĆÖexposition Jeff Koons au ch├óteau de Versailles indique bien comment le prestige historique du lieu peut conf├®rer cons├®cration, et plus value, ├Ā des ┼ōuvres contemporaines. Elle permet ├®galement de comprendre comment, en retour, les ┼ōuvres contemporaines viennent stimuler par leur actualit├® des lieux engonc├®s dans la torpeur de leurs prestige et pass├®. Au risque de d├®courager cette client├©le de lŌĆÖindustrie du tourisme dont les go├╗ts patrimoniaux ne sŌĆÖ├®loignent jamais tr├©s loin de la surface du pr├®sentŌĆ”
Entre le contemporain et lŌĆÖancien, cŌĆÖest gagnant-gagnant : le prestige de lŌĆÖhistoire contre le dynamisme de lŌĆÖactualit├®.
LŌĆÖart contemporain dans les mus├®es dŌĆÖart ancien, f├╗t-ce sous la forme indubitablement f├®conde de dialogues ou de contrepoints artistiques, nŌĆÖest devenu ┬½obligatoire┬╗ quŌĆÖen raison des imp├®ratifs de gestion commerciale des institutions artistiques. Il sŌĆÖagit, comme avec le design, de dynamiser et de rajeunir des lieux et des collections menac├®s de sŌĆÖassoupir, tout en drainant une client├©le nouvelle. Quant aux ┼ōuvres contemporaines, elles trouvent l├Ā un public, et une part de cette cons├®cration qui leur fait trop souvent d├®faut. Celles qui sont pass├®es par le Louvre pourrait ainsi avoir gagn├® une sorte dŌĆÖimmunit├® qui les pr├®serve du sempiternel soup├¦on du ┬½nŌĆÖimporte quoi┬╗ŌĆ”
Mais autant les conditions ├®conomiques et institutionnelles sont n├®cessaires aux actuelles mises en dialogue des ┼ōuvres anciennes et contemporaines (sous lŌĆÖaspect dudit ┬½art contemporain obligatoire┬╗), autant ces conditions seraient inop├®rantes sans lŌĆÖexistence dŌĆÖautres conditions, esth├®tiques celles-l├Ā, li├®es la contemporan├®it├® m├¬me des ┼ōuvres.
A cet ├®gard, une profonde m├®compr├®hension transpara├«t dans la d├®finition n├®gative et soustractive donn├®e de lŌĆÖart contemporain par le magazine qui, avec les adversaires doctrinaires de lŌĆÖart contemporain, consid├©re quŌĆÖil nŌĆÖest pas ┬½lŌĆÖart de notre temps, mais un art pur et dur qui a fait, peu ou prou, table rase du pass├® dans sa forme et son contenu┬╗.
Associer lŌĆÖart contemporain ├Ā la ┬½table rase┬╗, cŌĆÖest ignorer ce principe fondamental que la cr├®ation nŌĆÖest pas orient├®e contre les formes du pass├®, mais tendue dans une recherche des formes et des contenus du pr├®sent. Les artistes ne sont pas des destructeurs, mais des inventeurs de postures, de mat├®riaux, de protocoles, de lieux artistiques nouveaux pour mieux capter les vibrations inou├»es du pr├®sent.
La d├®finition de lŌĆÖart contemporain par son suppos├® rejet du ┬½pass├® dans sa forme et son contenu┬╗ (deux mots ├Ā entendre au pluriel !) m├®conna├«t gravement que les ┼ōuvres les plus novatrices sont celles qui sont les mieux habit├®es et instruites par celles du pass├®. Les ┼ōuvres ne naissent pas de rien, et lŌĆÖon ne cr├®e pas dans lŌĆÖignorance. Les artistes travaillent en permanence avec lŌĆÖhistoire, et non contre elle. LŌĆÖhistoire est leur premier mat├®riau.
Picasso, aujourdŌĆÖhui ├Ā lŌĆÖhonneur, a entretenu un dialogue artistique permanent avec les grands ma├«tres du pass├® dont il nŌĆÖa cess├® de r├®interpr├®ter les ┼ōuvres afin de mieux trouver, par ce recul, les formes picturales du pr├®sent.
Jan Favre, dont lŌĆÖexposition au Louvre (┬½LŌĆÖAnge de la m├®tamorphose┬╗, 11 avril-7 juil. 2008) est la cible dŌĆÖinutiles sarcasmes de la part du magazine, confie volontiers que Rubens, Jan Van Eyck, Bosch, et dŌĆÖautres peintres des si├©cles pass├®s, traversent toute son ┼ōuvre : ┬½JŌĆÖai emprunt├® ├Ā tous ces ma├«tres, ils ont nourri mon imagination┬╗ (artpress, sept. 2008).
LŌĆÖart contemporain ne se confond donc ni avec un art qui refuserait le pass├®, ni avec cet art dŌĆÖaujourdŌĆÖhui┬Ā (apparemment cher au magazine Vernissages) qui refuse le pr├®sent.
A partir des r├®flexions de Giorgio Agamben sur le contemporain, pourrait ├¬tre qualifi├® de ┬½contemporain┬╗ lŌĆÖart qui adh├©re ├Ā son temps tout en prenant ses distances vis-├Ā-vis de lui par d├®phasage et anachronisme. CŌĆÖest par son d├®calage avec lŌĆÖ├®poque que lŌĆÖart peut le mieux la percevoir et la saisir, la rendre visible, et fixer le regard sur elle.
Les ┼ōuvres peuvent ├¬tre contemporaines dans la mesure o├╣ elles parviennent ├Ā sŌĆÖaccrocher ├Ā cet impossible de rendre visible quelque chose du pr├®sent sans se fondre avec lui.
Andr├® Rouill├®
Lire
ŌĆö G├®rard Georges Lemaire, ┬½LŌĆÖart contemporain obligatoire┬╗, Vernissages. LŌĆÖart par ceux qui le vivent, n┬░2, oct.-nov. 2008, p.16.
ŌĆö Jan Fabre, ┬½LŌĆÖange coupable┬╗, interview par Rapha├½l Cuir, artpress, n┬░ 348, sept. 2008, p. 32.
ŌĆö Giorgio Agamben, QuŌĆÖest-ce que le contemporain ?, Rivages poche, Paris, 2008.
.

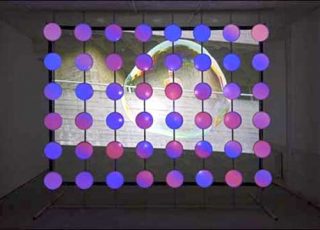
 parisART sur Instagram
parisART sur Instagram