Elisa Fedeli. Dans ÂŦDynastyÂŧ, vous exposez deux installations intitulÃĐes L’Homme le plus fort du monde 1 et 2. Quelle en est l’iconographie?
ChloÃĐ Maillet. Nous avons choisi de confronter les deux principaux personnages des pÃĐplums depuis les annÃĐes 1910: d’un cÃītÃĐ Maciste exposÃĐ au Palais de Tokyo, de l’autre Hercule exposÃĐ au MusÃĐe d’art moderne.
Maciste apparaÃŪt pour la premiÃĻre fois dans le film Cabiria (1914), sous la plume de l’auteur des cartons Gabriele d’Annunzio. C’est d’abord une ÃĐpithÃĻte herculÃĐenne (Hercule Maciste). Peu à peu, les deux personnages se sont scindÃĐs pour devenir indÃĐpendants, Hercule restant le hÃĐros mythologique et Maciste devenant une sorte de super-hÃĐros.
La vogue pour ces personnages date des annÃĐes 1910-1920. AprÃĻs une longue pÃĐriode d’oubli, ils font leur retour en Italie à partir des annÃĐes 1950, avec Les douze travaux d’Hercule (1956). Il est amusant d’observer que, dÃĻs lors, les films ne cessent de poser cette question: qui d’Hercule ou de Maciste est le plus fort? C’est sur cette tension que nos deux installations jouent.
Ces installations revisitent un genre cinÃĐmatographique, le pÃĐplum. Quel est votre rapport au cinÃĐma?
ChloÃĐ Maillet. Nous sommes intÃĐressÃĐes par le cinÃĐma de genre car c’est une forme qui a des rÃĻgles prÃĐÃĐtablies et des mÃĐthodes propres. Nos deux premiers films ÃĐtaient des films de science-fiction, qui rÃĐpondaient aux nÃĐcessitÃĐs de ce genre. Les sujets d’anticipation nous attirent car ils sous-entendent des projections temporelles, à partir d’hypothÃĻses sociologiques, anthropologiques ou philosophiques. L’Homme le plus fort du monde 1 et 2 est un film à sujet antique mais un dÃĐcalage temporel semblable y est en jeu.
L’enquÊte documentaire est inhÃĐrente à votre pratique. En quoi a-t-elle consistÃĐ pour ce projet?
ChloÃĐ Maillet. Aujourd’hui, ces pÃĐplums italiens des annÃĐes 1950-1960 sont difficiles à consulter et les copies sont mal conservÃĐes. D’oÃđ notre choix d’adopter une dÃĐmarche archÃĐologique, en prÃĐlevant certains ÃĐlÃĐments, un peu comme sur un chantier de fouilles. Attentives aux objets, aux dÃĐtails des costumes et au dÃĐcor, nous avons effectuÃĐ des relevÃĐs à partir de certains photogrammes. Par exemple, dans la projection du Palais de Tokyo inspirÃĐe du film Maciste l’homme le plus fort du monde d’Antonio Leonviola (1961), on peut reconnaÃŪtre les personnages-clÃĐs de l’esclave et du sorcier, les instruments de torture inventÃĐs par les hommes-taupes et la scÃĻne finale qui montre la libÃĐration de Maciste. La technique du relevÃĐ nous intÃĐresse car elle est à mi-chemin entre l’enquÊte scientifique et la rÃĐinterprÃĐtation. Les parties manquantes doivent Être complÃĐtÃĐes, ce qui s’apparente à un travail de reconstitution historique.
Vous avez dÃĐjà travaillÃĐ sur la spÃĐcificitÃĐ du bÃĒtiment lors d’une performance intitulÃĐe Le jeu de l’Exposition Universelle en 2009. Dans L’Homme le plus fort du monde 1 et 2, vous crÃĐez de nouveaux ponts avec l’architecture du Palais de Tokyo. Comment ce travail in situ s’est-il rejouÃĐ?
ChloÃĐ Maillet. Pour nous, la notion d’in situ est trÃĻs importante. De maniÃĻre gÃĐnÃĐrale, nos performances ne sont jouÃĐes qu’une seule fois et n’existent que pour le lieu oÃđ elles s’inscrivent.
Nous avons une histoire particuliÃĻre avec ce bÃĒtiment car nous y avons rÃĐguliÃĻrement travaillÃĐ. Son architecture nÃĐo-classique, construite pour l’Exposition universelle de 1937, naÃŪt aprÃĻs la premiÃĻre vogue du pÃĐplum en Italie tout en faisant encore appel à l’imaginaire de ce genre cinÃĐmatographique. Les deux ailes du bÃĒtiment ÃĐtaient tout à fait appropriÃĐes pour reconstituer la lutte fictive entre ces deux hÃĐros antiques.
Dans les deux installations, vous rÃĐactivez des dispositifs de projection archaÃŊques: une lanterne magique au Palais de Tokyo et un rÃĐtroprojecteur à transparent au MusÃĐe d’art moderne. Par qui peuvent-ils Être manipulÃĐs? Les considÃĐrez-vous comme des reliquats de performance ou des œuvres à part entiÃĻre?
ChloÃĐ Maillet. Leur intÃĐrÊt rÃĐside dans le fait qu’ils nÃĐcessitent d’Être activÃĐs manuellement. Pendant cette exposition, la projection est faite par un mÃĐdiateur, à heures fixes, plusieurs fois par jour. Ce sont des œuvres autonomes, qui recÃĻlent une part de performativitÃĐ. Nous ne montrons pas de reliquats de performance. Nous cherchons plutÃīt à donner d’autres interprÃĐtations des matÃĐriaux que nous collectons. Pour la mÊme raison, nous prÃĐfÃĐrons rÃĐaliser des films de fiction. Les vidÃĐos tirÃĐes de nos performances nous paraÃŪtraient une forme affaiblie.
Votre pratique est centrÃĐe sur la notion de ÂŦperformance didactiqueÂŧ. Quel lien existe-il entre cette idÃĐe et ces deux installations prÃĐcisÃĐment?
ChloÃĐ Maillet. Pour nous, la performance est une pratique centrale: c’est à la fois une mÃĐthode et une façon d’aborder les sources. Elle peut faire ÃĐmerger des artefacts.
Nous avons une prÃĐdilection pour les formes de performativitÃĐ non thÃĐÃĒtrales, ce qui est le cas par exemple de la confÃĐrence. Nous travaillons sur des espaces non scÃĐniques, souvent de plein pied avec le public. Notre discours reste à vocation didactique, mÊme si sa visÃĐe est brouillÃĐe par le montage des sources que nous ÃĐlaborons. Les mÃĐcanismes de la rhÃĐtorique nous intÃĐressent: dans quelle mesure y a-t-il une forme de thÃĐÃĒtralitÃĐ dans des discours qui ne servent qu’à transmettre du savoir?
AprÃĻs des recherches approfondies sur le sujet, nous fonctionnons par assemblage de sources de premiÃĻre main. Celles-ci sont forcÃĐment mÃĐtonymiques par rapport au sujet. La musÃĐographie — surtout celle des musÃĐes scientifiques et archÃĐologiques — est un champ qui nous ÃĐclaire à ce propos. LÃĐgendes, maquettes, schÃĐmas y sont les seuls ÃĐlÃĐments capables d’aider le spectateur à se faire une idÃĐe plus large du sujet ou de l’œuvre. Les artistes conceptuels amÃĐricains, notamment Lawrence Weiner et Douglas Huebler, ont beaucoup jouÃĐ sur ce type de prÃĐsentation dans leurs œuvres.


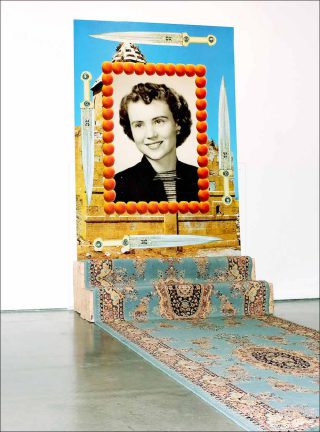



 parisART sur Instagram
parisART sur Instagram